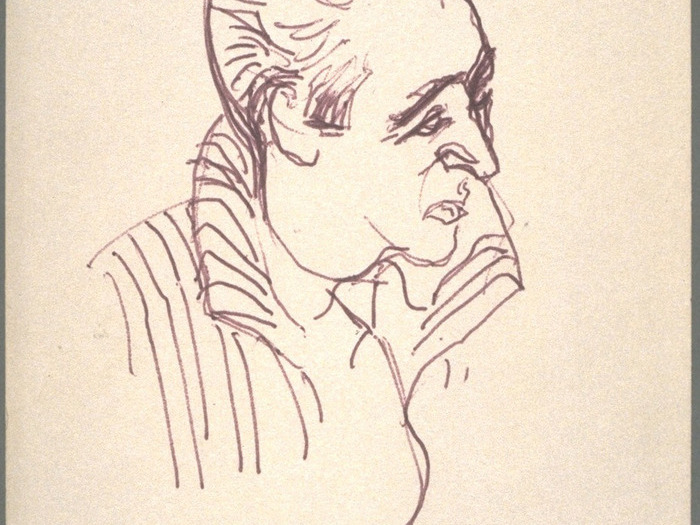« Si j'ose élever la voix tandis que mes frères tombent
C'est pour vous transmettre le relais de leur Espérance
Cette petite flûte de nos montagnes
Où la liberté s'engouffre
S'unit au souffle de l'homme. »
Jean Sénac, « Le soleil sous les armes », 1957
« Il est grand temps que l'on fasse un cinéma autre. » Nous sommes en juin 1972, au lendemain du festival de Cannes et du Grand prix de la critique internationale, et René Vautier évoque de façon humble et modeste Avoir 20 ans dans les Aurès à la télévision. Pourtant, si le geste, libre, engagé et enragé apparaît aujourd'hui comme une nécessité absolue, l'histoire de la production et de la diffusion de ce film reste tout sauf simple. Avoir 20 ans dans les Aurès pose les bases d'un cinéma de lutte et témoigne d'une guerre que les autorités envahissantes voulaient sans images, chaque scène est une reconstitution fictionnelle dont peut être vérifiée l'authenticité « par au moins cinq personnes ».
En cette rentrée 2012, la Cinémathèque française, en collaboration avec la Cinémathèque de Bretagne, répond à la nécessité de restaurer Avoir 20 ans dans les Aurès.
De la nécessité de restaurer les films de René Vautier
« J'ai toujours considéré une caméra comme une arme de témoignage. Mais ce n'est pas une arme qui tue. Au contraire, ça peut être un instrument de paix. C'est pour cela que je me suis bagarré pendant cinquante ans pour qu'il y ait des dialogues d'images, et tous les films que j'ai faits, je considère que ce sont des dialogues d'images. Le réalisateur prend parti. Il s'engage d'un côté, mais il donne aussi la parole aux gens d'en face. »
René Vautier
Toute une vie caméra citoyenne et indignée au poing : tout au long de sa carrière de cinéaste militant, René Vautier ne cesse de s'engager contre le capitalisme, le patronat, le racisme mais reste aussi et surtout l'un des plus grands dénonciateurs du colonialisme. Et de constater la dure vie des pamphlets visuels et des mains (« fragiles » ou « coupées », pour citer Marker) qui les réalisent : tournages accidentés, montages clandestins, négatifs confisqués, commission de censure, inculpations, condamnation pour atteinte à la sûreté intérieure de l'état, emprisonnement, grève de la faim, dégradation et destruction des copies, conditions illégales de diffusion, séances hautement menacées, attentat. Ces tentatives de mise en péril sont des actions régulières contre le cinéaste intègre et son œuvre, grande « comme une main ouverte » (pour citer Jean Sénac).
Grâce à l'action de Nicole Brenez, René Vautier est régulièrement présent à la Cinémathèque française, sur l'écran et dans la salle : en 2000, lors de la rétrospective Jeune, dure et pure : une histoire du cinéma d'avant-garde et expérimental en France, à l'occasion d'un focus « Écrire l'histoire en images, tout de suite : tortures en Algérie », au détour d'un portrait (réalisé par Oriane Brun et Leila Morouche, cycle « L'avant garde par elle-même »), d'un « Dialogue d'images » coorganisés par Zaléa TV, d'une journée d'études INHA « René Vautier, le cinéma de haute lutte », ou encore récemment pour les 50 ans de la Semaine de la critique.
Depuis 2007, la Cinémathèque française participe à la campagne de préservation des films de René Vautier initiée par l'association Más o menos (dirigée par Moïra Chappedelaine-Vautier, fille du cinéaste) et la Cinémathèque de Bretagne, active sur le chantier dès 2003.
Ainsi, des copies neuves de plusieurs courts métrages devenus invisibles ont été réalisées : Les Trois cousins, Les Ajoncs, Afrique 50 ou encore La Folle de Toujane (copie étalonnée par le chef opérateur Pierre Lhomme). Certains négatifs des films furent déposés et conservés depuis dans les collections de la Cinémathèque française.
La restauration d'Avoir 20 ans dans les Aurès s'inscrit dans cette campagne de sauvegarde et de diffusion de l'œuvre de René Vautier mais aussi, de façon plus générale, au cœur de la mission de préservation d'un film important du cinéma français. La célébration de l'indépendance algérienne, des 50 ans du cessez-le-feu et autres accords d'Évian serait presque à considérer comme une coïncidence cynique face à tant d'actions « officielles », d'escamotages médiatiques et artistiques menés pour que ce film humaniste ne puisse exister, être vu et entendu.
René Vautier raconte non sans humour qu'une bombe lancée par l'armée française explosa tout près de lui alors qu'il filmait aux côtés des indépendantistes pendant la guerre d'Algérie. Certaines images des villages détruits apparaissent d'ailleurs dans Avoir 20 ans dans les Aurès. Lors de l'explosion, une partie de sa caméra s'incrusta dans son crâne. Gravement blessé, il fut transporté clandestinement en Allemagne de l'Est pour y être soigné. Mais des morceaux de la caméra, trop proches des zones cervicales, n'ont pu être retirés. Depuis, René Vautier est le seul cinéaste à avoir « une caméra dans la tête ».
Après le maquis de l'Armée de libération nationale en 1956, la fondation du centre audiovisuel d'Alger, la mise en place des ciné-pops (dispositif unique de séances et débats itinérants), René Vautier continue de participer au destin de l'Algérie contemporaine et entame le tournage d'Avoir 20 ans dans les Aurès, dont le scénario s'inspire de centaines de témoignages de soldats français de la guerre d'Algérie, et de l'expérience de Noël Favrelière, jeune appelé déserteur et auteur de l'ouvrage Le désert à l'aube, publié aux éditions de Minuit, interdit tandis que son auteur est condamné à mort. Primé à Cannes en 1972, le film courageux fait scandale. Il est censuré à la télévision et dénoncé. Il demeure l'un des films les plus puissants réalisés sur la guerre.
Avoir 20 ans dans les Aurès parle de la guerre d'Algérie, et plus généralement des guerres, des terres occupées, de la nécessité de tuer au combat : sujets éternellement d'actualité. C'est aussi l'œuvre d'un grand cinéaste qui joue avec ses jeunes acteurs en plein désert (Philippe Léotard, Alexandre Arcady, Hamid Djelloudi, Jean-Michel Ribes) comme sur une scène d'improvisation. Les visages silencieux, entre autres celui d'Alexandre Arcady, qui refuse de tirer mais qui nettoie régulièrement son arme afin de la rendre comme neuve, demeurent inoubliables. Surtout, les regards des appelés farouchement antimilitaristes s'opposent au point de vue brutal et convaincant du lieutenant (formidablement interprété par Philippe Léotard) qui défend son engagement militaire. René Vautier filme cette confrontation avec distance, selon un choix de mise en scène surprenant, qui encourage la réflexion.
Les moyens numériques les plus perfectionnés ont été mis en œuvre pour retrouver les qualités originelles du film. Les travaux ont été menés au laboratoire Digimage, sous l'expertise technique d'Hervé Pichard et de Florence Tissot pour la Cinémathèque française, en association avec Moïra Vautier. Le projet bénéficie de l'aide sélective du CNC à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine. Les travaux sont également financés grâce à la Cinémathèque française, la Cinémathèque de Bretagne et la Région Bretagne, le Festival du film français de Richmond.
Le négatif et les éléments de tirage étaient stockés au laboratoire LTC, inaccessibles depuis plus de 20 ans pour des raisons juridiques. Il était devenu impossible de disposer d'une copie non dénaturée ou abîmée, que ce soit sur support 35 mm ou vidéo.
Après le déblocage des éléments chez LTC, les négatifs originaux (négatif et mixage original magnétique 16 mm) et éléments de tirage (internégatif inversible 35 mm, internégatif son 35 mm) ont été expertisés au laboratoire Digimage à Joinville-le-Pont et les premiers tests numériques ont pu être menés. Le film a été tourné en 1971, en 16 mm, puis gonflé en 35 mm. La qualité du négatif 16 mm est bien supérieure à celle de l'internégatif inversible 35 mm. Le gonflage réalisé en 1972 est un élément de deuxième génération (perte de netteté, image rognée sur les quatre côtés).
Ainsi, si le négatif 16 mm demeurait le support de référence pour la qualité des images, l'inversible 35 constituait l'élément de référence pour le montage définitif (certaines scènes n'existent que sur ce support). Il a donc été également numérisé pour intégrer les séquences uniques. Enfin, les collures entre les plans avaient été coupées dans le montage définitif : à chaque changement de plan, deux à quatre photogrammes avaient été supprimés. La conformation numérique respecte ces coupes, établies et voulues lors de l'exploitation du film.
Quant à la restauration sonore, elle est réalisée à partir du magnétique son 16 mm et de l'internégatif son 35 mm. Ces supports, en partie dégradés, ont été numérisés à partir du prototype Résonances mis au point conjointement par l'École des mines, l'Université de la Rochelle, GTC et Sondor.
L'étalonnage a été effectué par Pierre-William Glenn. L'ensemble de la restauration a été validé par Moïra Vautier et la Cinémathèque française en août 2012.
La version restaurée en résolution 2K est respectueuse du format image (1,37:1), du montage et du son d'origine. Un fichier IMF est produit, permettant le tirage de DCP de qualité pour une diffusion nationale et internationale. Un nouvel internégatif est prévu pour assurer la conservation du film et le tirage de copies 35 mm. La Cinémathèque française conserve un DCP ainsi que deux copies 35 mm (dont une sous-titrée en anglais) destinées à des projections exceptionnelles.
Malgré la fragilité des éléments image et son d'origine, la restauration est étonnamment belle, conservant les couleurs et la texture granuleuse de la pellicule 16 mm. Le film, dont la liberté des propos a marqué l'histoire du cinéma, retrouve ainsi toute sa force visuelle.
Diffusion et valorisation
Sur proposition de la Cinémathèque française, Avoir 20 ans dans les Aurès a été sélectionné à la 69e édition de la Mostra de Venise (section Venizi Classici). Une sortie en salles est prévue à l'automne 2012 avec l'appui de la coopérative Direction humaine des ressources. La Cinémathèque de Bretagne et la Région Bretagne sont également associées au projet de diffusion du film (19 salles du réseau CinéPhare). Un projet d'édition DVD (coffret) pourrait voir le jour auprès des Editions Montparnasse, ainsi que plusieurs possibilités de VoD.
Depuis 25 ans, les spectateurs, que ce soit en salle de cinéma ou à la télévision, n'ont pu accéder à une diffusion du film dans de bonnes conditions techniques. Il est enfin temps de pouvoir le montrer.