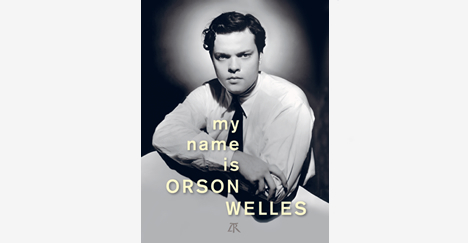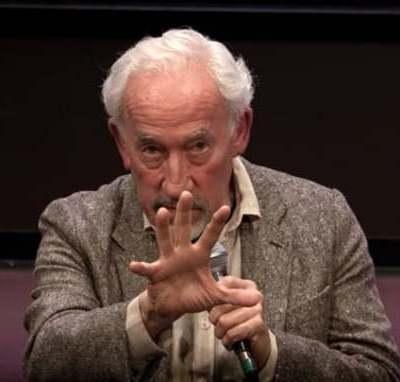Exposer Orson Welles revient à déployer dans l’espace les méandres d’une vie placée tout de suite sous le signe de l’exception : un garçon doué de tous les talents, un jeune rebelle qui préfère l’aventure européenne (Irlande et Espagne) à une bourse pour Harvard, comète de Broadway et prince de la radio – comme interprète et adaptateur/metteur en ondes de génie –, jeune premier pressenti par Hollywood, avant que la RKO ne rafle la mise après le scandale de La Guerre des mondes et déroule le tapis rouge au débutant absolu. Acteurs (lui et sa troupe, le Mercury) et sujet de son choix, budget confortable, obtention du fameux final cut : Welles avait fait monter les enchères et finalement obtenu les pleins pouvoirs, soit l’impensable pour une industrie cinématographique qui appliquait la division du travail et avait la manie du contrôle à toutes les étapes de la fabrication.
Premier film d’un tout jeune homme déjà célèbre, comme le soulignait François Truffaut, film le plus attendu de son temps, menacé d’interdiction par son modèle principal (William Randolph Hearst, redoutable tycoon des médias et protecteur de l’adorable Marion Davies), immédiatement proclamé génial par certains et vilipendé par d’autres, souvent à la solde de Hearst, Citizen Kane réussit un prodige éternel, renouvelé à chaque vision et devant chaque nouveau public : le film ne déçoit jamais, alors qu’il n’a rien perdu de sa capacité à déconcerter. Le cinéma, le plus souvent, préfère sidérer et ne recule devant rien pour y parvenir, alors que Kane paraît se contenter de troubler pour mieux accomplir sa révolution et toucher aux fondements mêmes d’un art du spectaculaire partagé. Comment s’étonner alors que sa ressortie mondiale, en grandes pompes, de 1959, précéda de peu l’éclosion de la Nouvelle Vague ? Il y a des signes qui ne trompent pas : quand on remet Kane en route, ce sont soudain cent fleurs qui s’épanouissent.
Exposer Welles, c’est donc montrer, preuves à l’appui, qu’il avait déjà fait beaucoup de choses avant Citizen Kane, et que non, son œuvre ne s’est pas arrêtée là, même si, pour une fois, c’est le film qui finit par faire obstacle au nom, au lieu de l’inverse.
Citizen Kane reste au centre de tout, et se taille la part du lion dans une exposition qui se veut la plus complète et la moins inexacte possible. Pièce centrale du puzzle Welles, place forte du labyrinthe que constitue une filmographie de bric et de broc, presque insaisissable à force de versions différentes, de fragments et d’inachevés, Kane tient son rang de parfaite œuvre d’art, née sous les plus favorables auspices, mais qui contient aussi sa part maudite : autoportrait dépréciateur d’un visionnaire tyrannique, prophétie maléfique et autoréalisatrice, accomplie avec un tel alignement d’astres, si idéal, qu’il ne pourra jamais plus se reproduire. Et effectivement…
Exposer Welles revient alors à raconter comment il lui a fallu se réinventer, lui et son cinéma, après Citizen Kane, en prêtant sa marque et son prestige d’ange déjà déchu au gracieux Troisième Homme. Ou en inventant littéralement de toutes pièces un cinéma européen et indépendant d’après-guerre avec Othello, film aussi audacieux que Kane, absolument étranger au cinéma de son temps, avec pour seul viatique le plus grand écrivain du monde, ce Shakespeare que Welles comprenait mieux que personne, l’ami des comédiens et des ivrognes, qui a écrit définitivement les affres de la souveraineté et la cruauté de la trahison, et comment les Rois et les génies, surtout eux, sont appelés à côtoyer les gouffres de la défaite et du déshonneur.
Exposer Welles, c’est essayer de montrer comment un intellectuel américain gavé de Shakespeare et de Cervantès, qui cite Montaigne à tout propos et n’en finit pas de s’imprégner de Conrad, quand il n’adapte pas Blixen avant tout le monde et démontre que Kafka est l’un de ses intimes, ce qui n’allait pas de soi, est aussi un homme de spectacle jusqu’au bout des ongles. Un metteur en scène de théâtre qui va chercher Jules César pour parler du fascisme qui monte, et un magicien professionnel qui n’hésitera pas à couper en deux Rita Hayworth, alors son épouse, ou Marlene Dietrich, son amie pour la vie, pour distraire les soldats en permission à Los Angeles.
Orson Welles est une multitude, one-man-band pour reprendre le titre du beau film d’Oja Kodar et Vassili Silovic, et quand il s’adonnait au dessin, à la peinture ou même à la sculpture (l’une des découvertes de cette exposition), ce n’était pas tout à fait en amateur, même s’il ne lui est jamais venu à l’esprit de monnayer ces talents-là, question de lucidité et aussi d’exigence. Les donner à voir permet de démontrer que ce littéraire, qui fut l’un des plus grands inventeurs de formes du XXe siècle, et l’un des monteurs les plus décisifs de toute l’histoire du cinéma, savait aussi penser avec ses mains d’artiste.
Exposer Welles permet aussi de raconter le roman d’une vie en même temps que tout un pan de l’histoire politique du siècle passé, en particulier américaine, ou comment les forces progressistes que Welles incarnait ont été combattues et chassées, avec le résultat final que l’on sait, le retour à une ploutocratie qui s’exhibe et se repaît d’elle-même.
Éditorialiste politique très marqué à gauche, homme des missions délicates pour Roosevelt, Welles sera finalement mort en plein reaganisme triomphant et on n’ose à peine écrire que Kane pourrait aujourd’hui s’intituler Trump. Ce serait trop simple, et surtout injuste pour Charles Forster Kane, infiniment plus séduisant et respectable que son lointain et monstrueux successeur – mais successeur quand même.
Exposer Welles, enfin, c’est tenter de faire la part des choses, entre la légende noire colportée par le conformisme déchaîné des contempteurs (« Pourquoi est-il devenu si gros ? Pourquoi n’a-t-il plus rien fait après Kane ? ») et la spirale négative des dernières années, quand Welles est devenu un avatar de lui-même, disséminé à travers la planète publicitaire, une présence massive et bienveillante, certes, mais réduite à la « danse de l’ours » sur les plateaux de télévision comme ultime existence publique, alors que les gammes filmées et les monologues face caméra s’accumulaient dans des garages à Los Angeles, où certaines bobines sont sûrement encore. Aux géniales paraboles des films, aux subtiles digressions qui en faisaient aussi le sel, succèdent les slogans publicitaires imbéciles et prétentieux. Heureusement que ce qu’on appelle la « pop culture » viendra le magnifier à nouveau, des Peanuts aux Sopranos, en passant par Theodore Roszak et son merveilleux thriller, La Conspiration des ténèbres, le meilleur livre jamais écrit sur le cinéma, avec « Orson » en guest star.
Exposer Orson Welles revient finalement à présenter tous les aspects d’une vie d’artiste en cinéma. En rendant hommage à celui qui est allé jusqu’à inventer un concept qui connaîtra un certain succès, celui d’Auteur de films.
Frédéric Bonnaud




Une exposition conçue et produite par la Cinémathèque française
Commissaires d’exposition : Frédéric Bonnaud, Commissaire général, assisté de Hannah Froidevaux
Conseillers scientifiques : Esteve Riambau et François Thomas