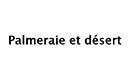Raymond Depardon
Du 14 novembre au 1 décembre 2013
Le cinéma parlant de Raymond Depardon
Avant de devenir le grand documentariste que l’on sait, Raymond Depardon était photographe reporter. S’il n’a jamais abandonné l’image fixe, il suffit de voir ses films pour comprendre combien le silence de la photographie était insuffisant à exprimer la parole que s’échangent ses personnages. Dès lors, le cinéma était tout désigné pour prendre le relais et combler cette absence.
Un cinéaste de la parole
S’il y a en effet quelque chose de récurrent chez Depardon, c’est la façon dont les êtres n’en finissent pas de négocier, jauger l’adversaire, décrypter l’autre ou tenter de le convaincre. Négocier, discuter, parlementer, c’est même le sujet principal de ses films. Ce ne sont pas seulement des personnages qui conversent dans un rapport d’égalité, délié et gratuit, ni même ce qu’on appelle en anglais le « small talk », cette langue de tous les jours qui relève de l’échange quotidien, désintéressé et superficiel. Au contraire, la langue filmée par Depardon est toujours pourvue d’une arrière-pensée, elle a souvent trait à un métier, une fonction. Et c’est pourquoi, sans doute, Depardon a filmé au coeur même des institutions (policiers, reporters, juges, médecins, etc.). Son film sur la campagne présidentielle de Valéry Giscard d’Estaing (1974, une partie de campagne) est probablement un des premiers à enregistrer la fin de l’ère idéologique de la politique et l’entrée dans celle de la communication (Giscard y dit, en substance, qu’il faut aller à Monceau-les-Mines, parce que cela sonne juste, social).
Ce qui intéresse manifestement le cinéaste dans ce film, au-delà de la silhouette presque tatiesque du futur Président, c’est la façon dont le langage est utilisé pour convaincre les foules et détruire l’adversaire. Une langue du négoce social et humain, dont Depardon tire souvent des scènes extraordinaires de vérité : des photographes qui parlementent avec Richard Gere pour prendre une photo, la façon dont ils se mettent les flics dans la poche en évoquant le salaire de la star (Reporters) ; un policier horripilé par le zèle tatillon d’une infirmière refusant de lui livrer les résultats d’une analyse, qui fait presque du chantage en la mettant face à ses responsabilités ; le même qui, jouant un peu la comédie de sa fonction, annonce à une jeune femme accusant un homme de viol le risque qu’elle prend si elle se parjure (Faits divers) ; des paysans intraitables qui résistent aux manipulations affectives d’un acheteur qui fait mine de s’en aller pour les faire céder (Profils Paysans) ; une prévenue qui ment (sans grand succès) à un avocat et à une psychologue pour éviter la prison (Délits Flagrants, Muriel Leferle). On pourrait ainsi multiplier les exemples de scènes où la parole prend une valeur stratégique. Sans jamais d’ailleurs que cela relève d’un quelconque cynisme ou d’un calcul froid et manipulateur. C’est souvent une langue chaude que filme Depardon (exception faite de Délits Flagrants, dont la parole professionnelle a quelque chose de glaçant), une langue où l’affect n’est jamais très loin, même quand la fonction oblige à garder une distance avec le sujet. Il faut voir par exemple cette infirmière, dans Urgences, qui tente de convaincre une patiente suicidaire de se faire interner. La séquence est longue, il faut du temps et une patience inouïe à l’infirmière pour parvenir à faire accepter l’idée à la jeune femme qui s’y refuse, du temps aussi et un respect humain des plus élémentaires pour ne pas la brusquer et faire avec son désespoir. Même chose, sur un mode comique, quand Jacques Chirac se fait prendre à parti par un commerçant (Reporters) et se tire de son léger embarras (le commerçant l’a traité un peu complaisamment) par une pirouette langagière (« la maison est bonne en qualité et bonne en humeur » dit-il à une cliente avant de quitter la boutique).
Le peuple et l’institution
On sent bien que ce qui plaît à Depardon, c’est le plaisir que l’un et l’autre ont pris à cette petite joute verbale, la manière dont les échanges racontent quelque chose de la vie de la cité. Les films de Depardon ressemblent à des agoras où le peuple et l’institution dialoguent et échangent, dans un rapport démocratique (chacun s’y exprime librement) même si nécessairement un peu inégalitaire (la parole de l’institution reste celle du pouvoir et certains personnages lui résistent, comme cet homme qui s’échappe d’un bureau au tout début de Urgences). Et ce qui est beau, c’est la façon dont malgré tout les institutions (la police, l’hôpital) génèrent des rapports humains, au-delà de la fonction assignée à chacun. De ce point de vue, Délits Flagrants est un film limite – glaçant comme on l’a dit – parce que c’est une des rares fois où le fonctionnement de l’institution supplante et même formate les rapports humains. On a beaucoup glosé, à l’époque de sa sortie, sur la main tendue du prévenu que le juge ne serre pas car sa fonction de juge prime sur ce geste de sociabilité et qu’il se muera, pendant le procès, en procureur de l’affaire.
La caméra de Depardon, posée latéralement aux deux protagonistes, insiste d’ailleurs sur ce bureau imposant, presque démesuré, qui sépare le juge du prévenu. Ce simple choix de cadre, s’il décrit froidement les choses (une froideur parfois reprochée au cinéaste) dit aussi quelque chose de ce moment particulier de la justice où les hommes ne sont plus là pour négocier mais n’ont plus d’autres choix que de subir la machine judiciaire qui s’est mise impitoyablement en marche. Et c’est peut-être la raison pour laquelle Depardon réalisera un film (Muriel Leferle) à partir de la matière non montée de Délits Flagrants, s’intéressant à une jeune femme volontaire et touchante qui, à sa manière, dans le film, réussit à instaurer un rapport avec ses interlocuteurs qui dépasse un peu le cadre protocolaire et contraignant de l’institution. Si en apparence Depardon ne prend jamais parti, certains plans ne laissent pourtant aucun doute sur la pente humaniste du cinéaste. Pour preuve, sa façon de recadrer sur les mains anxieuses de la jeune femme accusant un homme de l’avoir violée (Faits Divers) où Depardon sort soudainement du rapport protocolaire de la situation pour entrer en empathie avec son personnage. Toujours est-il qu’il y a souvent un bureau dans les films de Depardon, un bureau qui sépare et met une distance, ou encore une table de café qui organise un échange (Paris), une table de cuisine qui plutôt que de séparer relie et réunit (Profils Paysans). Mais cette obsession des échanges verbaux, de la négociation en ce qu’elle génère du rapport, trouve son exact négatif dans l’oeuvre même du cinéaste. Depardon éprouve une tendresse particulière pour les abîmés de la vie et ce qui se profile parfois à l’horizon, ce sont ces zones où l’être est pris dans les rets de sa propre prison intérieure. La folie (les soliloques des patients de San Clemente), la solitude (Profils Paysans) ne sont jamais très loin et avec elles ces moments où précisément ça ne communique plus, où le silence nie soudain tout rapport. Dans une séquence extraordinaire du troisième volet de sa trilogie sur les paysans (La Vie moderne), Depardon filme le mutisme de son interlocuteur tandis qu’en off, à la télévision, on entend des commentaires plein de fatuité sur l’enterrement de l’Abbé Pierre.
La tentation du désert
Au-delà de la dimension politique de la scène (le même dispositif critique est d’ailleurs utilisé dans San Clemente), la solitude extrême du paysan passe à travers ce non-dialogue entre lui et l’écran de télévision et par la difficulté même que Depardon éprouve à communiquer avec lui, comme si le langage s’était perdu, à tel point raréfié dans ce coin reculé des montagnes que l’homme en avait perdu l’usage. C’est pourtant un des rares films où Depardon s’implique physiquement (son bras bord cadre, sa voix qui pose des questions), là où d’ordinaire il tente de se faire oublier (« faire le lampadaire, bouger le moins possible » a-t-il coutume de dire quand il évoque sa méthode). Certains films de Depardon sont travaillés par cette zone blanche, semblent mus par la tentation du désert où les mots soudain se taisent. Il n’est pas étonnant, à ce titre, que Depardon ait réalisé une fiction à partir de l’histoire de Françoise Claustre, cette ethnologue otage de rebelles tchadiens pendant plus de mille jours, dont il avait ramené un témoignage filmé.
La Captive du désert décrit un personnage (joué par Sandrine Bonnaire) face au vide, à l’absence de parole commune (sinon quelques fois avec les femmes de la tribu) qui n’a plus rien à négocier, qui n’a plus qu’à attendre, enfermée dans un désert sans fin comme les fous de San Clemente dans les couloirs de l’hôpital vénitien. L’image elle-même se vide, loin du bruissement incessant de la vie urbaine que Depardon a si souvent filmée. Dans son dernier film, Journal de France, on voit d’ailleurs quelque chose de ce travail d’évidement alors qu’il se filme lui-même traversant des paysages désertiques, en montagne ou en bord de mer, renouant un temps avec le travail solitaire du photographe et avec le mutisme de l’image fixe, comme pour se ressourcer.
Jean-Sébastien Chauvin