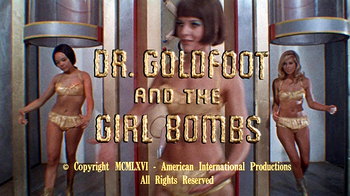Mario Bava
Du 3 au 28 juillet 2019
Le Rouge des origines
« Bien d'autres poètes ont senti la richesse métaphorique d'une eau contemplée, en même temps, dans ses reflets et dans sa profondeur. » (Gaston Bachelard)
Il arrive parfois que l'histoire du cinéma, tout comme les théories existantes ou les indices biographiques, ne parvienne pas à fournir les moyens qui permettraient la compréhension globale, totalisante, si une telle chose était possible, d'une œuvre. Lire celle de Mario Bava à travers le prisme des genres apparaît plus qu'insuffisant, illusoire et finalement totalement fallacieux. Vouloir la comprendre en se contentant d'examiner le contexte d'une évolution du cinéma italien depuis l'après-guerre serait une entreprise en partie vaine. Essayer de la replacer dans les catégories d'une histoire linéaire du cinéma qui serait passée du classicisme au maniérisme, puis au moderne, voire au postmoderne, serait prendre le risque d'une errance sans réponse. Il y a quelque chose de miraculeux dans l'idée que les structures du cinéma transalpin d'après-guerre aient pu rendre possible l'existence d'une œuvre comme celle de Mario Bava.
L'imaginaire contre le réel
Certes, généalogiquement et même biologiquement, Bava semble accompagner le destin d'une partie du cinéma italien qui s'opposait radicalement et idéologiquement à l'idée de réalisme. En reprenant les fonctions de son père, Eugenio Bava, lui-même directeur de la photographie et inventeur d'effets spéciaux ayant collaboré à quelques classiques du cinéma muet (Quo vadis ?, Cabiria), il semblait prolonger un art essentiellement dirigé vers l'imaginaire. Et ce prolongement prendra même l'allure de la résurgence d'une forme que l'on pensait périmée (le péplum), résurgence dont il sera à la fois le contemporain et l'un des responsables à la fin des années 1950. Dans ce conflit qui opposait les tenants d'un regard réaliste comme révolution esthétique et promesse d'émancipation sociale et ceux qui exaltaient un art de la fantaisie et de l'adaptation littéraire flamboyante, Bava semble se situer du coté des seconds, du côté de Riccardo Freda plutôt que de celui de Roberto Rossellini. Mais plus radicalement sans doute que l'auteur de L'Évadé du bagne, qui construisait ses films avec le maximum d'intensité réaliste à l'intérieur d'un monde inventé de toutes pièces, Bava se dirigera vers la fabrication d'un univers purement cérébral, détaché de toute référence à l'idée de nature, un maelström de pulsions et de sensations. Le geste figuratif cesse, dans son œuvre, d'être en contradiction avec l'abstraction la plus pure. L'usage de la couleur y déjoue tout naturalisme. C'est sans doute pour cela qu'il est impossible de penser l'œuvre de Bava autrement que comme celle d'un artiste solitaire et unique.
C'est en 1959, après être intervenu sur plusieurs productions dont il fut partiellement le metteur en scène (Les Vampires et Caltiki, le monstre immortel de Riccardo Freda, Les Travaux d'Hercule et Hercule et la reine de Lydie de Pietro Francisci) – en plus d'en être le chef opérateur, génial bricoleur capable parfois de sauver des projets douteux à vil prix – qu'il signe son premier film comme réalisateur. Dans Le Masque du démon, la mythologie gothique est profondément subvertie par une mise en scène faite de longs plans virtuoses, arabesques dévorant le genre de référence pour dessiner un monde en trompe-l'œil et en phase de putréfaction. La corruption de toute chose, l'auto-dévoration, fût-elle celle de la construction sociale de base qu'est la famille, devient un des mouvements qui va définir toute son œuvre, des Wurdalaks en 1963 (segment des Trois visages de la peur) aux Démons de la nuit (1978) en passant par L'Île de l'épouvante (1970) ou La Baie sanglante (1971).
L'image qui saigne
Mais l'œuvre de Bava abolit la figure humaine telle que le cinéma l'a construite depuis ses origines, jusqu'à faire du motif horrifique « hoffmannien » de l'objet qui s'anime, de la poupée qui prend vie, le principe même d'une méditation morbide. Les mannequins en osier de Six femmes pour l'assassin se confondent presque avec des personnages animés s'en distinguant par la pulsion brute qui les meut jusqu'à l'autodestruction. Du héros de Duel au couteau qui trompe ses ennemis avec un épouvantail – une réplique de lui-même en paille –, jusqu'aux grandes poupées manipulées par le diable lui-même dans Lisa et le diable, véritable manifeste poético-théorique, le corps est devenu objet, une transmutation qui est celle produite par la mort.
L'image elle-même est au centre du cinéma de Mario Bava. Non pas comme un référent qui aurait doublé et remplacé le réel ou qui aurait engendré de nouvelles images, mais comme un organisme doté d'une vie autonome. L'œuvre de l'auteur de Danger, Diabolik ne peut se réduire, en effet, à une lecture maniériste, postmoderne, construite sur la mémoire du spectateur lui-même, sur l'idée que les simulacres se sont substitués soit à la réalité, soit à d'autres simulacres. Elle participe d'une véritable organicité de l'image, une image indécise, vacillante, liquide, une image qui saigne. L'usage du zoom, des effets de focales, du flou, ne procède pas d'une volonté « moderne » d'imprécision et d'inachèvement, mais du retour vers un chaos originel dont on n'a peut-être pas encore élucidé le secret.
Jean-François Rauger