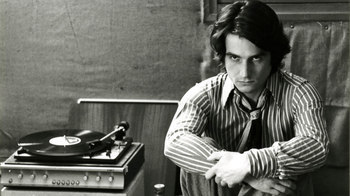Cinéma français et chansons
Le 13 juillet 2015
1929/1939 : le parlant est né. Du coup : des chansons dans trois quarts des films, trop souvent en forçant le ton avec des astuces de commis-voyageurs.
Mais comme ça, on vend plein de « petits formats » à chaque coin de rue, et surtout beaucoup de disques et les phonos suivent.
1940/45 : l’Occupation tempère les gaudrioles. On chante encore dans les films, mais comme partout c’est plutôt le tocsin bien tempéré. Espoirs, regrets, attente, souvenirs plus que quelques trépidations en prime pour les Zazous.
1950 à nos jours : « Les années TSF ». Les familles se lovent autour du « Poste ». La radio crée les chanteurs et les vend, les cinéastes font ce qu’ils peuvent. Mais voici que rappliquent transistors, mini cassettes, FM, radios libres et la Nouvelle-Vague qui va inventer de nouvelles noces avec la chanson : Varda, Demy, Eustache, Godard… Aujourd’hui : des clips, des biopics, des essais élégants, du charme, peu d’abattage. On peut tous les trouver sur Internet, tout va bien !
Mais moi, qui suis un enfant du phono et des 78 tours de mes parents. Bambin, j’ai tout entendu et souvent écouté, de Georgius à Lucienne Boyer, d’Ouvrard à Gilles et Julien, d’Andrex à Damia.
Ray Ventura fut ma Comtesse de Ségur et Jean Sablon mon Capitaine Nemo. Aussi, quand beaucoup plus tard on me demanda de dégoter des chansons du ciné des années trente (du « Samedi-soir, » pas « les classiques ») je savais que j’allais passer du temps avec des paroles et des musiques qui, tour à tour, m’épateraient, me charmeraient, ou m’écoeureraient. Les films ? Pas beaucoup de chefs-d’oeuvre, mais trop souvent des travaux plus ou moins forcés de metteurs en scène dont Truffaut louait, non sans humour, l’insuffisance modeste… Mais quelle importance devant les pétulances distinguées des partitions d’un Van Parys, la pesante fantaisie d’opérettes allemandes ravigotées par des séducteurs bien de chez nous, les sympathiques travaux à la chaîne de l’insubmersible Jean Boyer, le charme acidulé de Danielle Darrieux, les stratagèmes bas-de-gamme de Garat ou Préjean, la bondissante euphorie de Pills et Tabet, les maladresses autoritaires d’un Gabin débutant… Horreurs de l’embarras du choix !
(Un comédien de l’époque, me voyant travailler, me surnomma « l’écailler du cinéma » !). Mais Ciné-Follies ne sent pas toujours très bon. La vulgarité joviale de Milton est le symbole d’une société qui roule vers le désastre. Chevalier dans « Le chapeau de Zozo » définit une France plutôt « multiple ». Ajoutez quelques traces de racisme rigolard ; de misogynie coquine, le tout brodé sur la peur de manquer, d’où un flamboyant égoïsme !
Quand Ciné-Follies s’achève, le pays est mûr pour l’envahisseur et la nostalgie en prend un coup. C’est tout ça la chanson ? Oui, mais on ne peut pas lui reprocher sa forte charge (involontaire ?) de lucidité critique. On s’endort avec Jean Tranchant pour se réveiller avec Marc Bloch.
D’ « ici l’on pêche » à « l’étrange défaite ». Heureusement, Maurice nous rassure : « Et tout ça, ça fait d’excellents Français… ! »
C’est Alain Resnais qui, 50 ans plus tard, aura le dernier mot : On connaît la chanson !
Philippe Collin