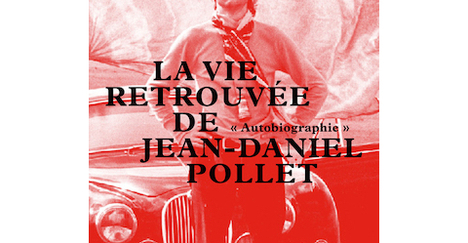Jean-Daniel Pollet
Du 12 au 30 août 2020
Vertiges de l'espace-temps
Cadet de la Nouvelle Vague, Pollet est aussi sa plus belle promesse. Pourvu qu'on ait l'ivresse révèle, en même temps qu'un grand cinéaste, un apprenti tailleur, Claude Melki, figure burlesque instantanée, contrepoint rythmique pénétrant par effraction dans ces images documentaires saisies au fil des dimanches passés dans les guinguettes. Son corps traverse aussi en funambule La Ligne de mire. Ce premier long métrage, resté sous clé depuis 1959, conte avec une rare douceur quelques fragments de mémoire, d'amour et d'amitié agencés en un montage – déjà – sériel, qui ramène sans cesse son narrateur vers un même lieu d'où il observe le passage du temps et le cycle des saisons. Un programme dont Pollet va creuser profondément les sillons. Il fait grandir Melki aux dimensions du Cinémascope dans Gala, somptueuse prémonition du cinéma de Jerry Lewis, puis entreprend un périple de 36 000 km dont il ramène une cinquantaine de plans intemporels : vagues, pyramide, femme au miroir... La logique onirique de Méditerranée distribue cet alphabet d'images comme les notes d'une gamme musicale, à l'unisson ou en contrepoint du commentaire de Philippe Sollers et de la partition d'Antoine Duhamel. Le courant du film, perpétuel ressac, est aimanté par des visions obsessionnelles : statuette du Dieu Horus, corrida, fille à la fleur... Entre la vie et la mort, il ne conserve que le substrat du récit : son suspense. D'où l'importance sensorielle et métaphysique des silences et mouvements suspendus, syncopes et contretemps qui renvoient le spectateur au vertige de son exacte dimension dans le cosmos.
La technique et le rite
Pollet fut fasciné par les perspectives du Nouveau Roman, mais ses films sont tout sauf littéraires. Leurs textes, signés Alexandre Astruc, Jean Thibaudeau ou Maurice Born, restent des rushes. Coupés, montés, ils contribuent à la dimension polysémique et polyrythmique d'un maillage où le passé se reconstruit à chaque inscription dans le présent des images, dans le mouvement de leur déroulement. Dans Bassae, Pollet quadrille les ruines du temple avec une lenteur majestueuse, il charge d'une extrême densité la symétrie dévastée de ses masses de pierre. Sa science de l'optique et du montage le prémunit de toute déperdition dans le chemin qui mène de l'œil à l'écran. Chaque travelling, en explorant un espace, produit aussi du temps. Comme son contemporain John Coltrane, il limite son faisceau à quelques motifs entêtants dont il épuise les combinaisons (allant jusqu'à mettre ses films en lambeaux dans Contretemps), et convoque l'invisible par exploration méthodique des possibilités de son instrument. Étranger à la notion de direction d'acteurs, il n'intervient pas plus sur les élans boulevardiers de Jean-Pierre Marielle, Guy Marchand ou Micheline Dax que sur la parole déchirante du lépreux Raimondakis, mais règle leur position dans la surface de l'image. La caméra impulse l'énergie du ballet des corps autant qu'elle s'en nourrit, qu'elle suive Melki « l'acrobate » dans son accession à la grâce, ou les hippies du Sang dans le mouvement perpétuel de leur trajectoire vers le rivage. Un imaginaire sans artifice. Une roue tourne, un chien lèche le cadavre d'un mouton, et Pollet renverse le théorème de Godard : ce n'est pas du rouge, c'est du sang.
Seul
Dans ce cinéma matérialiste, le spectacle naît de la mise à distance provoquée par une écriture qui se désigne comme telle. Quelle que soit la forme qu'elle emprunte, comme le montre sa trilogie de l'enfermement et de l'évasion. Une balle au cœur explore les névroses d'un homme terrassé par la peur, acculé dans sa chambre d'hôtel, courant enfin vers la lumière, la maison, le soleil, la mer et la mort, en un maelstrom d'images comme décollées du récit, arrachées au système commercial qui les a produites. Autant, alors, adapter Le Horla, où la folie clinique du personnage contamine les couleurs des objets et des murs, ou mieux encore, convoquer un mythe universel. Tu imagines Robinson parachève les recherches de Méditerranée dans une fiction linéaire, mais déstructurée, conjuguée au conditionnel. Échoué sur une île, Robinson scrute la ligne infinie de l'horizon, reclus en lui-même, hanté par quelques images fantasmagoriques ramenées par les vagues. Pollet filme un corps en lutte avec les éléments, ses gestes de survie, le flot désespéré d'une parole en prise avec la folie. Cauchemar en plein jour, visions hallucinées et pourtant inscrites à l'écran, dans le temps réel de la projection, de sa fantasia concrète de variations de couleurs, de lumières, de textures de sons.
« Bien sûr, ici je n'ai pas la mer, mais elle est dans ma tête »1
En 1990, Pollet, renversé par un train, frôle la mort. Ce drame intervenu en cours de production teinte Trois jours en Grèce de la couleur bouleversante du souvenir. Dernier voyage baigné de lumière méditerranéenne, assombrie par une télévision qui diffuse les images de propagande de la guerre en Irak. Tel un fantôme, Pollet, l'homme-caméra, traverse les espaces à une vitesse fulgurante, plane au-dessus du sol, rôde autour des visages, et s'éloigne pour leur dire adieu. Puis rentre dans sa maison d'où il interroge le mouvement et la fixité dans trois beaux films sur l'ordre de la nature. « J'essaie de mettre autant d'énergie dans l'image que cette fleur m'en donne », dit-il en ouverture de Jour après jour. Jean-Paul Fargier termine ce film posthume et consacre à Pollet un émouvant portrait où il l'exhorte à nous parler encore.2 Ses films continueront à le faire, à jamais.
Damien Bertrand
- Jean-Daniel Pollet dans Jour après jour
- Parle-moi encore (2016)