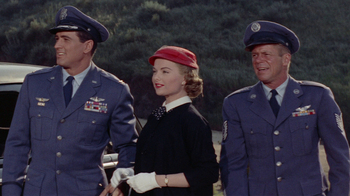Douglas Sirk
Du 9 novembre au 30 décembre 2005
Le temps de voir et d’aimer Sirk
Soyons honnête : sans Rainer Werner Fassbinder, je n’aurais jamais entendu parler de Sirk. En découvrant ses films, on voit bien tout ce que Fassbinder lui a « piqué », mais en voyant ceux de Fassbinder on a l’impression que tous ceux de Sirk ont quelque chose de « fassbindérien ». Sirk doit autant à Fassbinder que Fassbinder à Sirk. Je me demande si le plus beau mélo, ce n’est pas cette historie d’amour entre deux cinéastes séparés par l’âge et l’océan.
Ca ne se démontre pas seulement par Tous les autres s’appellent Ali, le remake que Fassbinder a tourné de Tout ce que le ciel permet… Si le film semble le plus sexuel et le plus cruel de Sirk, c’est peut-être parce que Fassbinder en a donné directement sa vision, déformée bien sûr… Chez ce dernier, le jardinier n’est plus seulement un Américain un peu rustre qui tombe amoureux d’une veuve mûre, mais un Arabe ouvrier qui se marre avec ses potes quand on prend son grand amour pour sa grand-mère. D’ailleurs, celle-ci n’a plus une dizaine d’années de plus que lui, mais vingt-cinq ; ses enfants ne se contentent pas de lui acheter un téléviseur pour la consoler, mais l’un d’eux envoie un coup de pied dedans lorsqu’elle leur apprend qu’elle va épouser un type pareil… Aux différences d’âge et de milieu social, Rainer rajoute le racisme, pêché peut-être dans Imitation of Life (double hommage). Pourtant, c’est Sirk qui a le dernier mot. A la fin, si le jeune premier est alité, ce n’est pas parce qu’il s’est tapé un ulcère au boulot, mais parce qu’il est tombé de haut alors qu’il appelait dans le vide sa bourgeoise bien-aimée… un exemple entre mille de la cruauté sirkienne. Tous ses mélos qui mélangent, d’une façon criante (et quelques fois criarde), tragédie antique et roman-photo. Sirk, c’est Nous deux par Euripide ! Ca finit toujours bien, mais à quel prix ! Les rares happy ends chez Sirk sonnent comme des glas. Pour lui, il n’y avait rien de plus triste qu’une happy end…
L’imprévisibilité de Sirk est peut-être le trait le plus fort de son style. Et depuis le début. Dans sa période allemande, alors qu’il s’appelait encore Detlef Sierck, Douglas Sirk était le roi pour multiplier les fausses pistes et inventer des histoires aberrantes. Quand La Habanera commence, on peut penser à un petit film exotique des années trente avec corridas et espagnolades. La brusquerie raffinée de Sirk accélère les choses : en un baiser, Zarah Leander, la Suédoise en mal de sud, abandonne sa tante qui rentre au pays et se donne à Don Pedro, le puissant seigneur de l’île. Dix ans après, opprimée par son marie, elle se morfond aux Caraïbes. Nostalgique de la Suède, elle promet en chansons à son fils de lui faire bientôt découvrir son pays, et en attendant joue avec lui à la luge sur le tapis… Apologie de la neige aux Canaries ! Survient alors l’amour de jeunesse de Zarah, un chercheur qui vient enquêter sur la fièvre qui décime le pays du soleil et surtout pour ramener la belle. Don Pedro est jaloux et arrête le chercheur qui vient de trouver l’antidote au mal. Soudain, il tombe foudroyé par la fièvre : on pourrait le sauver grâce à l’antidote, mais il vient de le faire saisir et détruire. « Il a creusé sa propre tombe » dit le jeune savant suédois.
Pas d’ironie ou alors l’ironie du sort. Le Kyle d’Écrit sur du vent veut tuer son meilleur ami parce qu’il est persuadé que sa femme l’a trompé avec lui puisque lui est stérile : il la frappe, ce qui lui fait perdre l’enfant, mais c’était bien de lui qu’elle était enceinte (sa stérilité était une erreur médicale). La madame Phillips du Secret magnifique, devenue aveugle, ne peut pas reconnaître chez celui qu’elle aime le responsable de la mort de son mari… L’Ernst du film Le Temps d’aimer et le temps de mourir tue un autre SS qui voulait exécuter des prisonniers : il les libère mais l’un d’eux le tue à son tour. Il s’écroule près d’une rivière qui emporte dans son courant la lettre de sa femme lui annonçant qu’elle va avoir un bébé… Manques de pot ! Malencontreux hasards… Avalanches de catastrophes, scoumounes en cascades… Et aussi substitutions de forces, fatalités piégées, retournements de situations, volte-face du destin, taquineries divines, foutages de gueule du fatum… Bref, grande cruauté de Dieu et compassion pour tous les hommes.
La caméra de Sirk cherche à s’insinuer partout où elle va surprendre le plus de subtilités : elle gêne les acteurs, ou plus exactement les personnages. Si on la chasse par la porte, elle revient par la fenêtre. Ah ! Les fenêtres ! C’est chez Sirk comme chez Fassbinder une magnifique obsession. Tout est vu à travers une vitre. On croit toucher la réalité et c’est soi-même qu’on voit se refléter, c’est contre son reflet qu’on se casse le nez. Dans Summer Storm, George Sanders envoie son violon dans le miroir quand il surprend son propre reflet. La réalité visiblement inaccessible derrière une vitre : c’est peut-être ça, le cinéma. Fassbinder le virtuose a appliqué cette leçon à la lettre dans tous ses films. Une vitre est aussi un miroir. Sirk, mystique du miroir, disait qu’une glace montrait l’envers de l’homme. C’est cette distance qui empêche le spectateur de s’incarner bêtement dans le personnage, comme dans les œuvres d’art naturalistes.
Sirk ne faisait pas de différence entre un film d’action et d’émotions : « L’émotion, c’est une action à l’intérieur d’une personne ». Il l’a dit : en arrivant en Amérique, la façon dont on appelait les films lui a donné une indication de ce qu’il avait à faire. Movies motion pictures : images émouvantes mises en mouvement… Pour Sirk, la caméra est son double, elle doit être une jumelle de l’artiste. Elle passe à travers les portes, suit les rampes d’escaliers, s’insinue à travers les cannelures des chaises, derrière les paravents, les stores striant les visages… Rien ne l’arrête sauf un miroir. Un animal qui se voit dans un miroir ne comprend pas que c’est lui, mais chez Sirk les hommes sont pareils : chacun pense qu’il est un autre, et il a raison ! Les crises d’identité sont fréquentes. Quelqu’un fait quelque chose à la place d’un autre, ou bien quelqu’un devient quelqu’un d’autre grâce à un autre.
Voilà pourquoi les transformations deviennent des rédemptions. Le colonel « Killer » Hess de Battle Hymn a bombardé une école en Corée (37 enfants morts). Il deviendra une autre sorte de héros en créant un orphelinat. Dans All I Desire, l’actrice prétentieuse Murdoch, après avoir abandonné les siens, renonce à sa carrière médiocre et reprend sa vie de famille enrichie. On pourrait multiplier les exemples de rédemption chez Sirk, jusqu’au sommet,, le célèbre Hitler’s Madman avec John Carradine dans le rôle d’Heydrich qui, après avoir terrorisé la Bohème, tombe sous les balles des maquisards.
Attention ! Tout est piégé chez Sirk, même les rédemptions. Heydrich sur son lit de mort a mal. On croit qu’il va demander pardon, mais non, au contraire, il s’est trouvé trop « faible », il n’est pas dupe de l’illusion nazie, et prophétise à Himmler que les SS ont perdre la guerre. Himmler mentira au Führer ensuite au téléphone en lui faisant croire qu’Heydrich est mort en y croyant encore. Sirk arrive à émouvoir le spectateur sur ce monstre qu’on a vu pendant le film pousser une jeune Tchèque à se jeter par la fenêtre, ou bien interrompre un curé en pleine procession, le gifler, s’essuyer les bottes avec son linge sacré, et pour finir le tuer.
Comment Sirk parvient-il à rajouter une telle « fiction de haine » (aujourd’hui on dirait plutôt un « docu-drama »), une empathie pareille ? Parce que le diabolique Reichprotektor apparaît le plus lucide de tous. Heydrich, c’est l’athée complet qui veut vivre et non pas mourir pour une cause. C’est là que réside la véritable charge contre le nazisme : dans ce désaveu d’Hitler (même pour de mauvaises raisons), et dans cet amour de la vie de la part de quelqu’un qui aime aussi la mort. En ce sens, le Heydrich de Sirk est un sacrilège ambulant et par là-même le seul vrai mystique, celui qui se bat contre toute fausse religion, que ce soit la grotesque mixture en Bohème de paganisme et de christianisme ou bien l’autre, en Allemagne, qui mélange aussi pitoyablement nationalisme et socialisme… Au moment où il meurt, Heydrich n’est pas humain parce qu’il souffre, mais parce qu’il reste lui-même, c’est-à-dire un homme sans foi ni loi. Un fou, mais pas d’Hitler, un fou de vivre. Le christianisme de Sirk est celui d’un protestant absolument pas américain, mais nordique et germanique. D’où cette obsession de réparer les choses qui vont mal. Réparer la vie. Les héros des films de Sirk sont comme des mécaniciens chargés de démonter une voiture pour la réparer, ils s’en mettent plein les mains. Ils y arrivent quelquefois, mais jamais ils ne parviennent à la remonter.
Ca commence par des pluies de diamants qui remplissent l’écran, et ça se termine par des avions en feu qui se fracassent contre des pylônes à damiers. Entre temps, il y a eu beaucoup de froncements de sourcils, de cris coincés dans la gorge, de gifles et de serrements dans les bras. Le tout dans de superbes couleurs bleutées et toutes sortes de jaunes, sauf d’œuf. Comme chez Bernstein lorsqu’il montre la nunucherie des riches (d’ailleurs, Bernstein n’a pas écrit un Mélo pour rien), on assiste chez Sirk aux conséquences désastreuses de la bêtise et de l’insensibilité de la bourgeoisie, de sa lenteur à réagir et de ses préjugés de tous ordres. L’œuvre de Sirk est une attaque à l’acide sulfurique du nouveau continent qui l’accueillait. Aucun Américain n’aurait pu, dans le cadre d’Hollywood, écorcher vive cette Amérique des années quarante et cinquante. Qui oserait, surtout aujourd’hui ! Montrer un aviateur noir américain pleurant contre sa carlingue au retour d’une « mission » où il vient de mitrailler des enfants ?
Un Sirk, c’est tellement tiré par les cheveux que toute la perruque reste dans la main. Un jeune cynique tombe amoureux de la veuve de celui qui est mort par sa faute, le plus fort c’est que c’est réciproque ! Et comme si ça ne suffisait pas, il est également responsable d’un accident qui rend cette pauvre femme aveugle, avant de reprendre ses études de chirurgie pour être capable de l’opérer lui-même à crâne ouvert (Le Secret magnifique). Un pilote d’avion qui fait un numéro de foire autour de pylônes forme un ménage à trois avec sa femme et son mécanicien jusqu’au jour où un journaliste veut devenir le quatrième larron. Chacun à sa façon pousse le pilote à monter dans un avion défectueux jusqu’à ce qu’il se crashe sous les yeux de son fils coincé dans un avion de manège (La Ronde de l’aube). Charmant ! Afin de protéger son amant, une chanteuse de cabaret s’accuse d’avoir falsifié un chèque et est condamnée à sept ans de bagne en Australie. Au retour, elle annonce à cet amant qu’elle ne l’aime plus. Ca se passe la veille de son mariage à lui, et il se suicide. L’ex-prisonnière supplie alors à la porte du bagne qu’on la ré-enferme, car désormais elle a une bonne raison d’être coupable de quelque chose et punie pour ça (Paramatta, bagne de femmes).
On pourrait raconter les films de Sirk pendant des heures, et à force ils pourraient devenir drôles, tellement ils sont énormes. Malentendus, quiproquos, révélations, saletés morales qui pourraient faire penser à du vaudeville, mais tragique.
Le « baroquisme » de Sirk n’est pas seulement dans son art de filmer, mais aussi dans la variété des thèmes et des époques. Il tape aussi bien chez les Irlandais que chez les apaches, les jésuites, les aviateurs, les soldats américains ou nazis, ou bien les Huns ! Le Paris de la Restauration contre l’Arizona du Far West ne lui font pas peur. Ni les figures historiques, Cochise, Attila, Vidocq, Heydrich, dont il tire les portraits comme personne. Le Vidocq de Sirk existe plus fort que le vrai, et même que le faux qui inspira Balzac. Quand Sirk est adaptateur, il l’est au sens électrique : il charge l’œuvre originale d’un nouveau courant. Faulkner trouvait La Ronde de l’aube meilleur que son Pylon. Et pour bien montrer que Sirk avait eu raison de corriger son titre, Erich Maria Remarque joue un rôle dans Le Temps de vivre et le temps de mourir.
Les personnages qui paraissent les plus pourris sont les plus purs : Marylee dans Écrit sur du vent, Sarah Jane dans Imitation of Life, LaVerne dans La Ronde de l’aube. Les jeunes délurées sont souvent les anges gardiens de ces femmes mûres pleines de rêve et d’égoïsme interprétées par Lana Turner, Jane Wyman ou Barbara Stanwyck. Séparées rêveuses ou veuves pleureuses, ce sont surtout des femmes fortes et « artistes », confrontées à de vrais sentiments mais continuant à affronter la vie comme dans un théâtre. Quant aux hommes, c’est à eux que revient la palme de l’ambiguïté ». Entre la force et la faiblesse, leur cœur balance tellement qu’il finit par se décrocher. Robert Stack dans La Ronde de l’aube et Écrit sur du vent, mais surtout l’acteur sirkien par excellence : Rock Hudson.
Dans presque tous ses films, Hudson est là. Fassbinder disait que Sirk filmait Hudson comme un simple figurant. Comment prendre un acteur médiocre et en faire le meilleur du monde ? Quelles que soient les situations incroyables dans lesquelles le film le fourre, Rock Hudson n’est jamais ridicule parce que Sirk le prend au sérieux. Qu’il incarne un journaliste, un jardinier, un aviateur ou un Peau-Rouge, Rock Hudson est toujours, finalement, une sorte d’amant de Lady Chatterley. Une armoire à glace dans laquelle les dames aiment à se refléter jusqu’à en vomir…
Il faudrait écrire un livre sur chaque film de Sirk pour espérer en venir à bout. Quelques lignes ne suffisent pas à en épuiser les richesses d’interprétations à tous les niveaux. D’ailleurs, Fassbinder dans son fameux texte sur les six principaux films de Sirk ne se prive pas d’en dire le plus possible. Il suffit de lire le texte de Godard sur le maître du mélo, plein de jeux de mots et de dérision, et celui de Fassbinder, bourré de sensibilité et de générosité, pour mesurer tout ce qui les sépare artistiquement….
Il a fallu beaucoup d’amour à Sirk pour faire ses films, mais il en fait beaucoup au spectateur pour les recevoir… Il est grand temps de voir et d’aimer Douglas Sirk.
Marc-Édouard Nabe