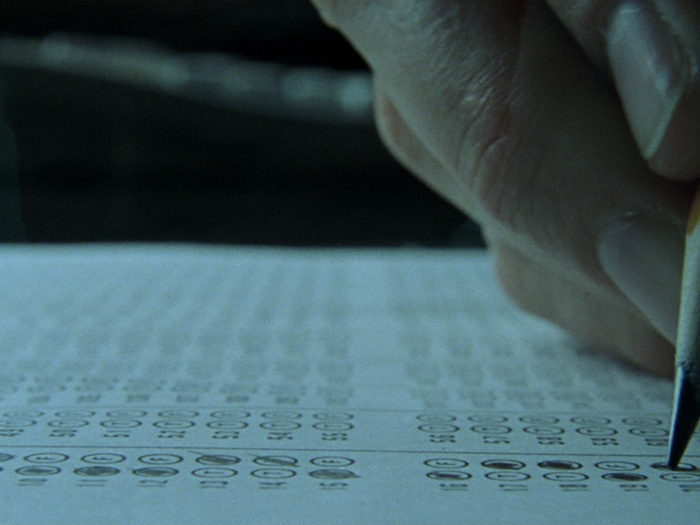Formé, dans les années 90, dans la manufacture du video-clips et de la publicité, dont il fut un des virtuoses, David Fincher a d’abord acquis la réputation d’un cinéaste habile et efficace. Son sens de l’épate visuelle allié à une attention scrupuleuse aux codes narratifs américains a pu ainsi dessiner la figure d’un brillant artisan défendant un formalisme glacial. Fincher, ce fut d’abord une signature visuelle emblématique, cristallisée dès Seven, son deuxième film, et qui a influencé durablement la photographie du cinéma de genre, au risque d’un imaginaire contraint. Face à des cinéastes de la même génération, le réalisateur semblait ainsi se conformer dans une image de wonder-boy attaché à un cinéma de divertissement ambitieux, appelé naturellement à vieillir avec la technologie des CGI dont il s’est montré d’emblée friand
Le piège perfectionniste
Mais ce perfectionnisme visuel s’est vite révélé comme le symptôme d’une obsession personnelle pour l'achèvement et la clôture. À l'instar d'Herman Mankiewicz, cité dans Mank (« Il semble que je devienne de plus en plus un rat pris à son propre piège »), les personnages de Fincher s'enferrent d'eux-mêmes dans des labyrinthes mentaux ou des images pièges. Malgré leur diversité de genre, tous les longs métrages de Fincher ont le ton d'un film noir. Dans ces enquêtes sur les structures du piège, il s'agit moins de trouver une porte de sortie que de transformer le chaos des gestes et des événements en une totalité leur donnant sens. Chaque film marque une quête d'accomplissement qui isole les personnages du reste du monde, comme les films eux-mêmes semblent s'isoler du réel, bouclés dans leurs propres images numériques.
Ce cinéma en circuit clos a pourtant très vite reflété un état de l'Amérique. À la fin de Fight Club, les tours du capitalisme occidental s'effondrent, deux ans avant celles du World Trade Center. En 1997, la descente vertigineuse de Michael Douglas dans les multiples réalités de The Game offre une image à la structuration paranoïaque qui s'est aujourd'hui étendue à toutes les couches de nos existences. D'être précisément forgé à l'écart du réel immédiat, ce cinéma lui a donc donné des images, mais il les lui a données en avance.
Le canon classique
Vingt ans après ces débuts, Fincher a donc désormais agrafé son nom à la liste volante des grands maîtres américains. Dernier contrebandier en date de Hollywood, il a placé sa maestria technique dans les pas du canon hitchcockien, influence avouée du génial Gone Girl. Du jeune homme intransigeant bataillant pour imposer aux Studios ses idées au metteur en scène gracieux d'un film rendant hommage à ses pères, symboliques et réel, avec Mank, c'est ainsi moins un itinéraire qui se dessine, qu'un univers qui se précise à travers une constante rigueur formelle. Rigueur dont il a lui-même pu définir le principe en célébrant une vision stricte du cinéma : « Les gens pensent qu'il existe un million de manière de tourner une scène, mais je ne le crois pas. Il n'y en a que deux, et l'autre est fausse. »
Un million, deux, un seul ? Derrière l'amusante formule rabbinique se devine un bricolage ontologique qui va du pluralisme à l'unicité du monde, en passant par le dualisme. Cette tension entre l'un et le multiple est au cœur de ce cinéma qui se lit moins thématiquement qu'esthétiquement. C'est dans son goût pour les gros plans sur les appareils technologiques que se forme une myriade d'indices, signaux venant trouer la narration jusqu'à l'emporter dans une indéchiffrable tempête de signes. L'univers chez Fincher se présente d'abord comme un codex énigmatique, au sens perpétuellement fuyant. La figure récurrente du serial killer vaut ainsi moins comme épouvantail maléfique que comme messager du chaos. La paix du quotidien, que le cinéaste filme toujours avec une scrupuleuse attention à ses détails et ses rythmes, est un voile illusoire qu'il vient déchirer, pour en révéler l'insignifiance. Aux héros, alors, de retrouver de l'ordre dans ce monde en ruines, en reclassant le puzzle de ses signes. C'est ici que Fincher s'avoue cinéaste classique : par cette inclination naturelle à vouloir filmer la lutte infinie entre l'ordre et le chaos, entre l'unicité symbiotique du monde et son éparpillement par des puissances antagonistes.
Filmer l'impossible
Derrière cette lutte, le formalisme fincherien repose cependant sur une conviction : le monde est un, puisque tout ne peut être filmé, donc interprété, que d'une seule manière. L'usage du numérique chez Fincher a été le moyen d'en parachever la recomposition, en inventant des mouvements d'appareils actionnés par un œil inhumain. Reste à comprendre l'instance derrière cet œil. Il suffit de remonter à la première image réalisée par Fincher, alors qu'il n'a que 22 ans : celle d'un fœtus fumant une cigarette. Image impossible tant elle défie l'ordre linéaire du temps. Même défiance dans son film le moins fincherien, partant le plus explicite : dans L'Étrange Histoire de Benjamin Button, le numérique permet d'inverser le vieillissement du corps de Brad Pitt. Et puis il y a Mank, sur un scénario écrit par son père défunt, dont les mots passés viennent littéralement griffer la surface de l'image. Les espaces piégés de ce cinéma sont des cristaux temporels où se rétractent passé et présent. Comme si, à force d'avoir voulu filmer le passage du temps, c'était le temps lui-même qui avait filmé cette œuvre.
Guillaume Orignac