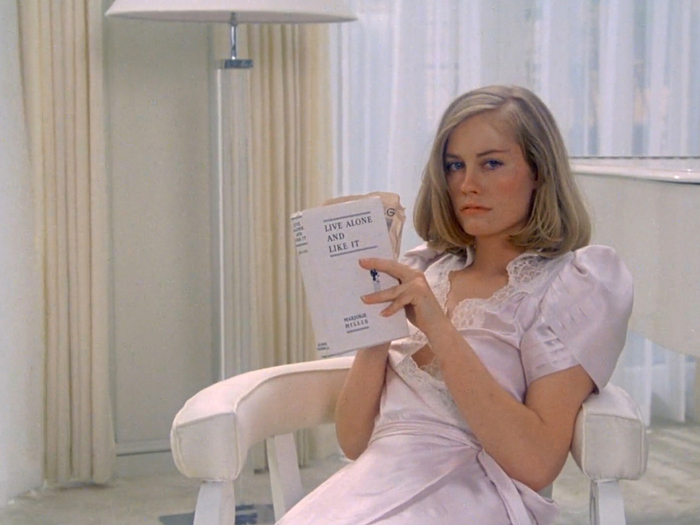D'abord un manifeste : « Tous les bons films ont déjà été faits ! », se lamente un jeune réalisateur au début de La Cible (1968) devant un extrait télévisé du Criminal Code d'Howard Hawks. Film dans lequel apparaît Boris Karloff, devenue depuis la star d'un cinéma d'horreur gothique suranné qui, à l'heure de l'assassinat de Robert Kennedy, de La Nuit des morts-vivants et de la guerre au Vietnam, s'apprête logiquement à tirer sa révérence. Peter Bogdanovich, dont c'est le premier film, interprète lui-même ce réalisateur novice qui passe l'essentiel de son temps au chevet de cette gloire usée, dans l'espoir de la convaincre de ne pas déjà raccrocher les gants. Il lui propose un dernier tour de piste, en somme, pour un film « moderne », à l'heure de cette fin des années 1960 anxieuses et euphoriques, un film qui cocherait toutes les cases de ce qu'on n'appelait pas encore le Nouvel Hollywood, et auquel l'autre récit de La Cible fait lui-même écho – un jeune homme de bonne famille qui, sans raison apparente, s'apprête à accomplir une tuerie de masse sur une freeway de L.A. Produit par Roger Corman, dont Bogdanovich fut, aux côtés de Francis Coppola, Jonathan Demme, Stephanie Rothman ou encore Monte Hellman, l'une des pousses prometteuses, La Cible est un film clivé. Parce qu'il est aussi organisé autour de deux élans a priori contradictoires (impulsion rétrospective / désir d'adhérer à l'époque), dont le futur réalisateur de Saint Jack tentera d'accomplir inlassablement la synthèse, depuis La Dernière Séance, le coup de maître qui fera de lui l'un des cinéastes les plus courtisés d'Hollywood au début des 1970, jusqu'à Broadway Therapy, son dernier film, en 2014.
La première partie de carrière de Peter Bogdanovich épouse la trajectoire rêvée d'une ascension fulgurante qui, en trois films (La Dernière Séance, On s'fait la valise, docteur ? et La Barbe à papa), l'a porté sur le toit de l'industrie hollywoodienne. Puis, au mitan des années 1970 et après avoir refusé de réaliser Le Parrain, L'Exorciste ou encore Chinatown, sa carrière marque commercialement le pas. Daisy Miller, film pourtant majeur adapté d'Henry James, dans lequel il tente de comprendre le paradoxe transatlantique via le chassé-croisé amoureux entre deux Américains exilés qui ne se comprennent pas, ne trouve pas son public. À cette conversation proustienne entre l'Amérique et l'Europe, Bogdanovich retourne à la case départ, loin des studios, de Hollywood et de l'hubris qui atteint alors la plupart des cinéastes de sa génération (Friedkin et Sorcerer, Scorsese et New York, New York, Cimino et La Porte du paradis, Altman et Popeye...) et sollicite l'aide de Roger Corman qui accepte de produire à bas coût Saint Jack, adaptation d'un roman de Paul Theroux qu'Orson Welles devait mettre en scène. Réalisé en 1979, Saint Jack suit le parcours erratique d'un Cosmo Vitelli de Singapour interprété par Ben Gazarra et ouvre peut-être le moment de grâce du cinéma de Bogdanovich (le merveilleux Et tout le monde riait et Mask). Moment de liberté aussi et d'émancipation à l'égard de modèles qui semblent plus lointains.
Né de parents d'origine serbe à Kingston, dans l'État de New York, en 1939, Peter Bogdanovich fut l'un des cinéastes les plus cinéphiles de sa génération. Il dédia, tout au long de sa vie et comme aucun autre, une part importante de son énergie à aller à la rencontre des vieux loups, à leur consacrer des articles, des livres, des documentaires (Directed by John Ford, The Great Buster) et même des rétrospectives (Orson Welles au MoMA en 1961). Dialogue continu, puisque tous ces films ont prolongé cette conversation au long cours avec les grandes formes du cinéma classique américain et ses maîtres (Ford, Hawks, Dwan, Lubitsch, Welles) dont Bogdanovich a toujours pensé qu'ils détenaient un secret qu'aucune vague nouvelle ne saurait périmer. Ainsi Les Raisins de la colère et Chaplin hantent La Barbe à papa, les screwball comedies de Preston Sturges et de Leo McCarey infusent tous les plans de On s'fait la valise, docteur ?, Enfin l'amour rend hommage aux comédies musicales des années 1930, Un parfum de meurtre replonge dans le scandale qui a secoué le landerneau hollywoodien de la décennie précédente (la mort suspecte du réalisateur Thomas Ince sur le yacht de William Randolph Hearst en 1924), et le goût fordien des communautés traverse toute sa filmographie à la manière d'une antienne américaine (La Dernière Séance, Saint Jack, Mask, Nickelodeon, Et tout le monde riait). Mais ce rapport admiratif et érudit à un âge d'or éteint, dont Nickelodeon revisite les commencements à la manière joyeuse d'une parade passée, fut pendant longtemps – et peut-être même encore aujourd'hui – l'objet d'un malentendu tenace, tant certains y ont vu une forme d'idolâtrie stérile (pourquoi vouloir refaire ce qui n'est plus ?) qui, dans le meilleur des cas, conduit au pastiche appliqué et, dans le pire, à un refus d'affronter le contemporain. Pourtant, dès La Dernière Séance, ancêtre splendide de tous les teen movies à venir, Bogdanovich conjugue l'aspiration du cinéphile à replonger dans ses premières amours (le cinéma des années 1950, le noir et blanc, un spleen fordien) et son désir de retarder le moment de leur évanouissement, avec un regard frontal, et parfois cruel, sur la réalité existentielle des habitants de cette petite ville du Texas. L'impulsion vers ce qui a disparu constitue le moteur mélancolique du cinéma de Bogdanovich, d'où son anachronisme de surface – Henry James en 1974, un film de bikers marginaux post-Easy Rider (Mask) en 1985 – et son goût pour les époques finissantes (La Dernière Séance, Saint Jack, notre enfance tout simplement).
Pour Bogdanovich, le cinéma, et plus précisément le cinéma hollywoodien classique et populaire qui en incarne une forme d'accomplissement parfait, ne fut donc ni une momie à débander ni la matière d'un nouveau simulacre, mais une philosophie de vie, proche de celle que théorisait Stanley Cavell dans La Projection du monde, paru la même année que La Dernière Séance. Dans Texasville (1990), le personnage interprété par Timothy Bottons soigne sa dépression en regardant, dans le ciel, des films qu'il est le seul à voir ; dans Broadway Therapy, une jeune actrice raconte à un journaliste venu l'interviewer l'histoire de sa vie et se révèle incapable de dissocier les événements qu'elle a vécus des souvenirs des films qu'elle a vus, comme si les et les autres participaient du même mouvement. La Cible, déjà, s'achevait dans un drive-in, au bas d'un écran de cinéma dont les images finissaient par se mêler à la réalité pour mieux la réparer. Dans les films de Bodganovich, le cinéma nous apprend la vie, parfois il la guérit, la console, l'embellit aussi, mais toujours, il la guide.
Jean-Baptiste Thoret