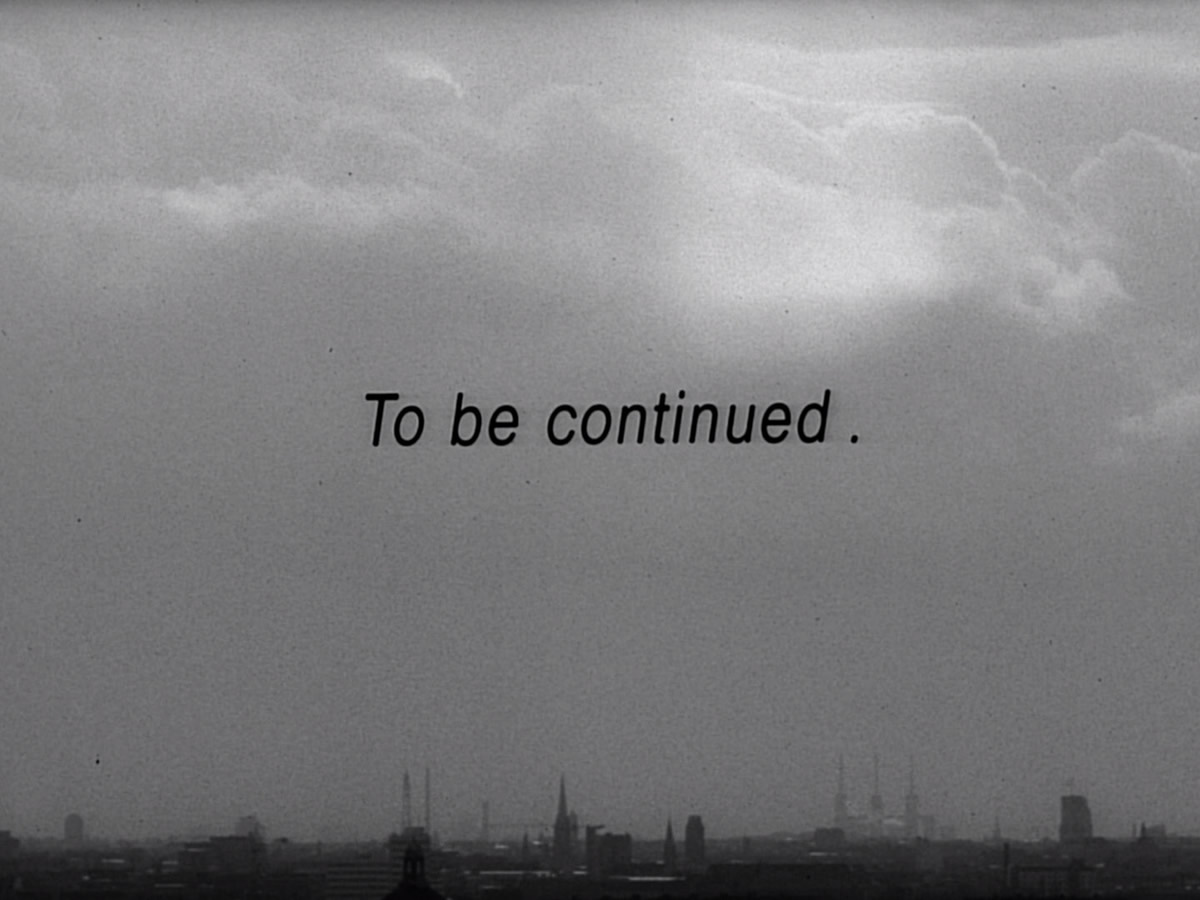Berlin, symphonie d’une grande ville (Walter Ruttmann, 1927)
Berlin, au petit matin. Un train traverse la campagne et arrive au centre de la capitale allemande. On est en 1927, sous la République de Weimar, entre-deux-guerres faussement apaisée où le nazisme n’est encore qu’à l’état d’embryon, dans une métropole dont le cœur bat vite, et fort.
« Depuis que je suis venu au cinéma, j’ai toujours eu l’idée de faire quelque chose avec la matière vivante, de créer un film symphonique avec les milliers d’énergies qui composent la vie d’une grande ville. » Walter Ruttmann passe à l’acte avec ce film en forme de documentaire. De l’aube au crépuscule, sa caméra explore les rues, accompagne la foule. S’arrête, repart, se cale sur le rythme de la ville, capte le quotidien et l’imprime sur pellicule.
Ouvriers, écoliers, badauds, noctambules. Vêtements, loisirs, travail, repas. Immeubles, usines, transports, cabarets… Berlin, symphonie d’une grande ville est le parfait témoignage historique et sociologique d’une Allemagne en mutation, mais aussi une déclaration d’amour à une ville et à ses habitants, à la beauté urbaine.
Allemagne année zéro (Roberto Rossellini, 1948)
« Ce film tourné à Berlin à l’été 1947 ne veut qu’être un tableau objectif et fidèle de cette ville immense à demi détruite, où 3 millions et demi de personnes vivent une vie désespérée s’en presque s’en rendre compte ». Dernier volet de la « trilogie de la guerre », après Rome, ville ouverte (1945) et Paisà (1946), dans lesquels Rossellini filmait la Résistance et la Libération, Allemagne année zéro s’ouvre sur ce préambule du réalisateur.
Rossellini creuse la veine du néoréalisme en faisant œuvre de documentariste. Il se penche sur les séquelles du conflit, suit l’errance du jeune Edmund dans les décombres du secteur français de Berlin défigurée. Berlin où des militaires américains se prennent en photo devant les ruines de la Chancellerie qui vit brûler les corps d’Hitler et d’Eva Braun. Berlin où les idées du nazisme continuent de se répandre sournoisement. Berlin où la population survit à peine, entre marché noir, menus larcins, et combines diverses. Edmund est le symbole d’une enfance à jamais abîmée, de cette génération désœuvrée qui doit désormais assumer la responsabilité des actes de la précédente. Une allégorie de l’Allemagne abandonnée à son sort, qui lutte pour se reconstruire sur des ruines encore fumantes.
La Scandaleuse de Berlin (Billy Wilder, 1948)
Presque 20 ans après L’Ange Bleu de Sternberg, Marlene Dietrich, toujours éclatante, chante de nouveau dans un cabaret berlinois. Mais cette fois, les morceaux s’intitulent Black Market ou The Ruins of Berlin… Nous sommes en 1947, et Rossellini est justement en train de tourner Allemagne année zéro. Sur le même sujet, Wilder a choisi l’humour, mais, sous couvert de comédie, lui aussi cartographie une ville détruite, raconte le quotidien des Berlinois aux existences soufflées par la guerre, qui survivent dans les ruines de la capitale entre marché noir et prostitution. Si le ton et la filiation Lubitsch/Wilder évoquent Ninotchka et ses flèches décochées contre le rigorisme soviétique, la verve satirique de Wilder vise le puritanisme américain, et écorne la propagande militaire de l’Oncle Sam. Mais le réalisateur ne se dérobe pas et montre aussi les stigmates du nazisme, sans concession.
Les séquences extérieures ont bien plus qu’un parfum d’authenticité : « A large part of this picture was photographed in Berlin » annonce le générique. Wilder est venu avec quelques opérateurs pour filmer des plans aériens, magnifiques, où s’étendent à perte de vue les quartiers en ruines, découpés comme de la dentelle par les bombes et les incendies. De la porte de Brandebourg à la Chancellerie, en passant par Unter den Liden, les avenues sont déchiquetées et grises, et les places abritent désormais le marché noir. Wilder dresse un tableau amer de la ville qui l’a vu éclore, écrivain et scénariste en devenir, mais sans jamais se départir d’un cynisme salvateur, comme celui de Dietrich/Erika von Schlütov : « accompagnez moi à mon appartement, c’est juste à quelques ruines d’ici »…
Le Rideau déchiré (Alfred Hitchcock, 1966)
Fragilisé par l’échec de Marnie, privé de son chef opérateur et de son monteur attitrés qui meurent juste avant le tournage, Hitchcock n’est pas au mieux lorsqu’il entreprend Le Rideau déchiré. Contraint de renoncer à Cary Grant et Eva Marie Saint, il doit composer avec deux stars imposées, qu’il méprise : Julie Andrews est trop fade, Paul Newman, trop vulgaire… Entre les deux acteurs et le Maître, l’animosité est palpable, et Hitchcock tord ses personnages jusqu’à les rendre antipathiques. À l’issue de ce tournage chaotique, Hitchcock, mécontent de la partition que lui propose Bernard Hermann, se brouille définitivement avec son compositeur.
Le Rideau déchiré renferme trois morceaux de roi, trois scènes typiquement hitchockiennes : la visite du musée, lointain écho à Vertigo. La poursuite en car, qui s’appuie sur une montée du suspense entre humour et effroi. Et enfin la séquence du meurtre, sommet de violence qu’Hitchcock justifiera plus tard : « J’ai pensé qu’il était temps de montrer combien il est difficile, pénible et long de tuer un homme. » Hitchcock délaisse peu à peu son intrigue au seul profit de la technique. Il joue avec la lumière et les filtres, accentue à dessein la grisaille qui pour lui incarne le Berlin de la Guerre froide. Les espaces sont vides, la population est triste et résignée. Il est alors quasiment impossible de tourner derrière le Rideau de Fer, et la plupart des scènes sont réalisées en studio. Mais Hitchcock pousse la minutie jusqu’à vérifier les horaires des compagnies aériennes, effectue lui-même les trajets entre Copenhague et Berlin, et fait réaliser en Allemagne de l’Est des enregistrements sonores qui apporteront une touche réaliste à son film.
L’Homme de Berlin (Carol Reed, 1953)
Berlin, 1953. Le Mur n’est pas encore construit, mais la capitale allemande est déjà partagée en plusieurs secteurs, séparés par des barrières et des postes de garde. Carol Reed s’est déjà approché du sujet à Vienne avec son Troisième homme, quatre ans auparavant, et renoue avec l’atmosphère glacée et oppressante de la Guerre froide qui s’installe. La première séquence rappelle étrangement l’ouverture de La Scandaleuse de Berlin : l’héroïne arrive d’occident et découvre la ville depuis le hublot de son avion. Reed a forcément vu le film de Wilder, même s’il ne montre plus les immeubles déchiquetés par les raids aériens mais le secteur ouest, relativement épargné et dont la reconstruction est déjà bien entamée.
C’est un peu plus tard que le vrai visage de la ville meurtrie apparaît, lors d’une promenade à l’Est. Au-delà de la porte de Brandebourg, toujours écrasante, frontière allégorique et matérielle entre les deux Allemagne, se trouve le secteur russe. Lorsque Bettina et Suzanne s’aventurent dans cette zone, Reed s’autorise un peu d’humour. Les rues sont envahies d’affiches de Staline, et le Petit Père des Peuples apparaît littéralement dans chacun des plans, sous tous les angles. Bien sûr, les décombres sont là, mais font partie du quotidien, comme l’explique un James Mason à l’accent allemand impeccable : « Ils font partie de cette ville. Le Berlinois ne les remarque même plus ».
Plus tard encore, lors d’une poursuite inoubliable dans la nuit, James Mason et Claire Bloom se dissimulent symboliquement dans les fondations d’un immeuble en reconstruction. Berlin est immobile sous une neige qui atténue la dureté de ses ruines et leur confère, l’espace d’un instant, une poésie inattendue.
Berlin Alexanderplatz (Rainer Werner Fassbinder, 1980)
10 mois de tournage entre juin 79 et avril 80, 100 comédiens, 3000 figurants,15 heures et 22 minutes de projection, 13 épisodes. À l’origine, un livre d’Alfred Döblin, monument de la littérature allemande sorti en 1929. À l’arrivée, un feuilleton télé signé Fassbinder.
En 1928, Franz Biberkopf, incarné par Günter Lamprecht, sort de prison plein de bonne volonté, désireux de se racheter une conduite. L’Allemagne, elle, est exsangue, blafarde comme l’a poétisée Brecht. On est à Berlin, dans le quartier d’Alexanderplatz. À la faune de prostituées, homosexuels, toxicomanes et marginaux, qui hantait les lieux depuis des lustres, est venue s’ajouter celle de l’entre-deux-guerres. Chômeurs, anarchistes, fascistes, c’est tout un pan de la société berlinoise, populaire, interlope, misérable ou juste médiocre, que Fassbinder passe au crible. Alexanderplatz et son quartier sont un petit théâtre où se joue une comédie humaine noire et grinçante.
Les autorités est-allemandes ne permettent pas de tourner in situ, alors une moitié du tournage se déroule en Bavière dans les décors déjà utilisés par Bergman pour L’Œuf du serpent. Et pendant les trois mois passés dans la capitale, certaines scènes sont filmées dans le métro de Berlin-Ouest, dans différents appartement et cafés de la ville, parfois encore miraculeusement intacts comme le petit bar où allait le propre père de Lamprecht.
Fassbinder découvre le roman à l’âge de 14 ans, mais mettra vingt ans à accoucher de son adaptation. Choc libérateur, lecture essentielle et fondatrice, le livre est pour lui « une aide véritable, vitale, concrète, nue ». Fassbinder chérit le roman, le respecte et le transpose avec minutie. S’en empare malgré tout, se le réapproprie, et finalement le recrache avec toute sa rage, son énergie, et une forte connotation autobiographique. En Döblin et en Franz Biberkopf, héros malheureux, Fassbinder pense avoir trouvé une forme d’alter ego, une même vision de la vie, une même perception de la société.
Berlin Alexanderplatz, c’est la force d’un témoignage qui dépeint un microcosme, une époque, une réalité implacable, c’est le cœur de Berlin, de l’Allemagne, de la République de Weimar toute entière. Bien plus qu’une simple « série parfois incroyablement brutale de petites histoires sordides dont chacune pourrait faire la une des journaux à sensation les plus obscènes », comme ironisait son réalisateur.
Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée… (Uli Edel, 1981)
Plongée dans le Berlin de la fin des 70’s par le côté glauque. Moi Christiane F., c’est l’histoire vraie d’abord parue dans la presse allemande, puis devenue un best-seller, de cette ado qui s’enfonce chaque jour un peu plus dans la drogue et la prostitution. Le réalisateur a filmé Berlin sans filtre : le S-Bahn qui file à travers des tours grises et sans âme, une discothèque branchée mais sinistre. Des appartements tristes, gris. Le toit de l’Europa Center sur lequel rayonne un immense logo Mercedes, comme pour mieux souligner la crasse, le désespoir et la mort qui hantent la sordide gare de Bahnhof Zoo, lieu de perdition qui mène tout droit en enfer. Le seul instant de grâce, on le doit à Bowie dont la musique porte le film, et qui apparaît le temps d’un concert capté en live. La nuit tente de bercer le film, mais les images restent crues, les passants sont indifférents, et Berlin est impitoyable.
Les Ailes du désir (Wim Wenders, 1987)
1987, l’Allemagne est toujours coupée en deux, Berlin est encore défigurée par son Mur. Mais plus pour longtemps. Après Paris, Texas, le cinéaste de l’errance se pose dans la capitale pour filmer une histoire d’amour, d’anges, d’humanité. Servi par le talent de l’immense chef opérateur Henri Alekan, Les Ailes du désir remporte un succès considérable, et de nombreux prix, dont celui de la mise en scène à Cannes, en 1987.
Pendant de longues séquences, en vol suspendu, Wenders accompagne ses anges et fait planer sa caméra sur la ville pour mieux la cartographier, pour recueillir l’essence d’une vie qui va se remettre à palpiter. Cassiel et Damiel veillent sur les gens, mais ne peuvent intervenir dans leurs destinées, ne peuvent rien toucher, rien goûter, partagés entre leur condition d’immortels et leur désir de ressentir. Les Ailes du désir raconte cette déchirure. Les Berlinois eux aussi sont écartelés, entre vie et survie, comme les humains entre la vie et la mort. « Y’a-t’il encore des frontières ? » s’interroge l’ange Cassiel. « Plus que jamais ».
Alors Wenders filme au plus près du mur, le suit, le contourne, le franchit même brièvement. S’attarde à proximité des gares, et revient vers Postdamer Platz, comme attiré par ce symbole de la béance de Berlin. Un vieil homme ne reconnaît plus sa ville dans ces espaces vides et morts, « ce n’est pas possible, ce n’est pas là ». Wenders enfonce le clou avec des images d’archives qui viennent ponctuer cruellement cette souffrance. Mais le cinéaste sait aussi s’attarder sur les routes, les carrefours, les voies ferrées, comme autant de métaphores des échanges possibles entre les êtres. Et nous montre des instants encore fragiles, mais annonciateurs d’un changement inéluctable : un film qu’on tourne sur la guerre, comme on tournerait une page, ou un concert de Nick Cave dans le Berlin underground de cette fin des années 80.
« Je ne renoncerai pas tant que je n’aurai pas retrouvé Postdamer Platz », martèle le vieil homme. Deux ans plus tard, le Mur qui traverse la place tombera enfin.
Le Pont des espions (Steven Spielberg, 2015)
Berlin, 1962, Pont de Glienicke. La CIA et le KGB procèdent à l’échange de deux hommes, un agent soviétique contre le jeune pilote d’un avion d’espionnage américain. L’histoire est vraie, et se prête parfaitement aux thèmes favoris de Spielberg, le destin exceptionnel d’un homme qui sauve des milliers de vies, une certaine idée de l’honneur et du patriotisme, et l’exaltation du bien et des valeurs morales. Sur un scénario co-écrit par les frères Coen, Tom Hanks découvre la vie dans la capitale allemande en pleine Guerre Froide. Une première incursion à l’Est, et un rhume le saisit, contamination et acclimatation impossible. Il sera à son tour le corps étranger qui vient parasiter le système du jeu codifié de la politique internationale, des petits arrangements policés entre maîtres espions. Un grain de sable qui vient faire bouger les lignes de démarcation : fil tendu entre deux mondes, l’avocat Donovan est comme le pont, lui aussi entre deux rives irréconciliables.
De la construction du Mur au quotidien des Berlinois, existences jalonnées par le manque et la peur, du fatalisme d’une population exténuée au temps suspendu des files d’attente, Spielberg s’empare des lieux avec force. Il recompose l’atmosphère de grisaille, le froid, le danger, avec efficacité, servi par son chef opérateur attitré, Janusz Kamiński. Et s’offre même le plaisir d’une devanture de cinéma qui passe un Wilder et un Kubrick en même temps que Le Village des damnés version british… Une bonne partie des scènes a été tournée en studios, mais Spielberg s’est attaché à utiliser dès que possible des décors réels, comme le vrai pont de Glienicke, l’aéroport de Berlin-Tempelhof ou encore la gare ferroviaire d’Erkner.
Victoria (Sebastian Schipper, 2015)
2 heures et 14 minutes. 22 lieux. 5 jeunes acteurs. Victoria est un pari, une audace. « Ce n’est pas un film sur un lieu, c’est un film sur des sensations, des sentiments que l’on retrouve en particulier à Berlin » explique le réalisateur, Sébastien Schipper. Un seul plan séquence nous entraîne, en temps réel, dans une déambulation à travers la capitale allemande. Victoria trace à grands traits énergiques le manifeste d’une génération pressée, avide, qui avance entre rage, désœuvrement et soif inextinguible d’adrénaline. Rues, parkings lugubres, halls d’hôtels, appartements, cafés, toits d’immeubles, la ville à l’aube s’offre à la jeune Espagnole Victoria et à ses quatre compagnons berlinois dans une errance et une fuite en avant à l’issue inexorable. Leur parcours peut symboliser celui d’un couple, ou même d’une vie : plus qu’un film, Victoria est une expérience, intense.
bonus
Tous ces films montrent un sens du détail, un souci de reconstitution, une recherche de réalisme qui portent à la fois la marque de leurs réalisateurs et le poids d’une histoire pas encore digérée. Pourtant, aujourd’hui, certains cinéastes s’autorisent à jouer avec une imagerie bien installée. C’est le cas de David Leitch.
2 ans après Spielberg et son Pont des espions, il réalise Atomic Blonde et prend à nouveau pour cadre le Berlin des barbouzes. Ode à une Charlize Theron iconisée dans une esthétique de pub glam-trash, le film fantasme la ville et déploie un catalogue de signes. En arrière plan, toujours des postes-frontières, des immeubles miteux, des Trabant et la Stasi. L’intrigue d’espionnage, les combats, les poursuites sont ponctués par des morceaux de New Order, Depeche Mode, Nena… Mais surtout, Leitch situe son intrigue dans la dernière semaine précédant la chute du Mur : sur les écrans de télés, aux informations, dans les manifestations, tout un système achève de s’écrouler, tout comme le réseau d’espionnage qui s’effondre en même temps tel un château de cartes. Le Berlin composite des espions, nationalités et allégeances entremêlées, préfigure le Berlin cosmopolite d’aujourd’hui et le film, étrange objet pop, cultive une forme de nostalgie pour les années 80 dont il fait de la ville un emblème.
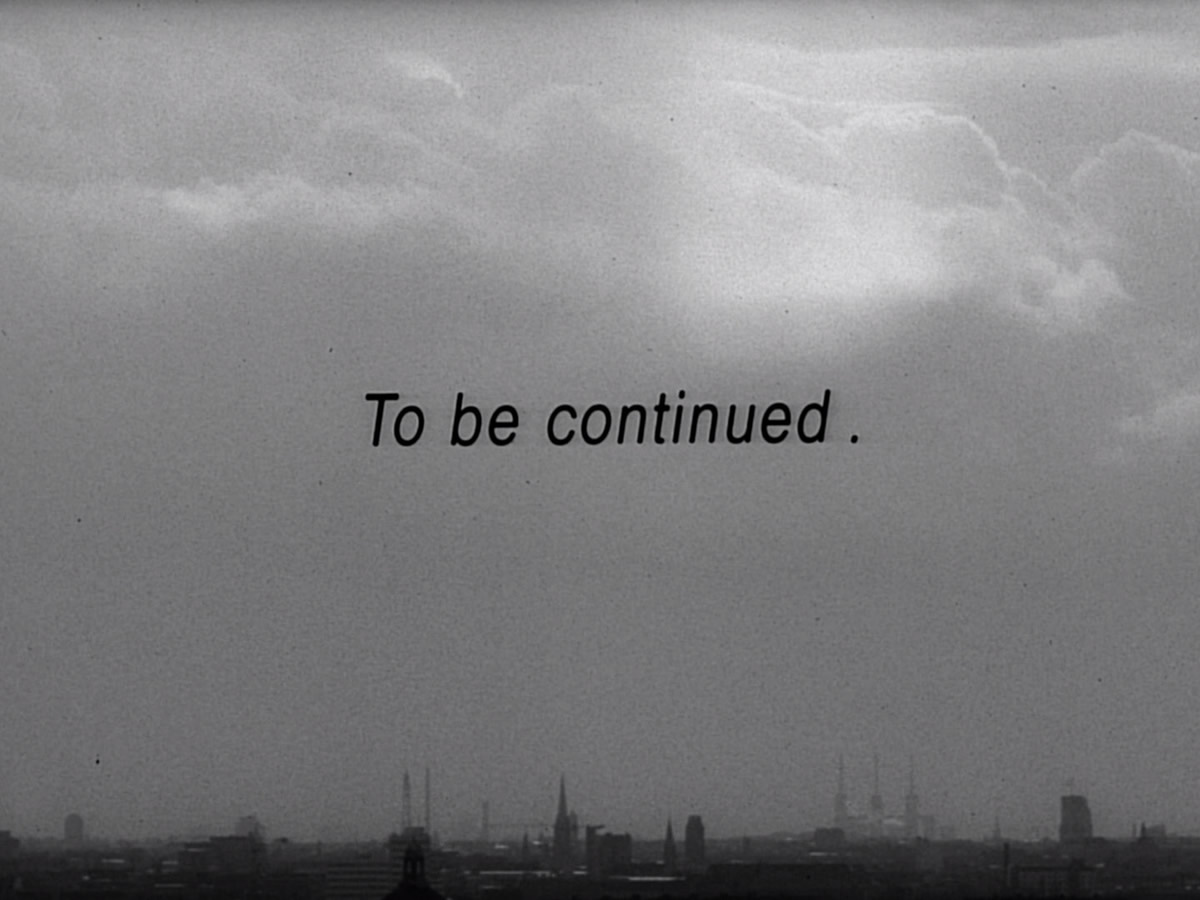
Les Ailes du désir