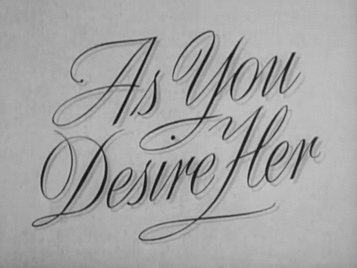Esther Ralston


Avant de jouer chez Dorothy Arzner, Esther Ralston a à son actif une somme de seconds rôles, de courts westerns et une poignée de longs. La grande blonde aux allures de mannequin tente sa chance depuis 1915 et la Famous Players-Lasky a beau vouloir en faire « The American Venus » avec le film du même nom (Vénus moderne, Frank Tuttle, 1926), sa carrière ne parvient pas vraiment à décoller. Elle n'est pas inconnue de Dorothy Arzner, monteuse et co-scénariste du précédent film de l'actrice, Old Ironsides (James Cruze, 1926).
Fashions for Women (Frivolités, 1927), premier film signé Arzner, est aussi le premier grand succès commercial d'Esther Ralston. Son double rôle dans cette comédie légère située dans l'univers parisien de la mode la fait passer au rang de star. Bilan du producteur Ben P. Schulberg, responsable de l'engagement d'Arzner : « Avec Fashions for Women, Dorothy Arzner a fait plus que remplir sa part du contrat : elle a non seulement réussi haut la main son passage à la réalisation, mais elle a aussi fait de son film le parfait écrin pour notre nouvelle star ».
Le studio remet donc le couvert avec Ten Modern Commandments (1927), comédie dramatique romantique. L'actrice, en passe de devenir l'une des mieux payée de la Paramount, est à l'honneur avec la troupe de danseuses de Marion Morgan. Compagne d'Arzner pendant 40 ans, déjà en charge des séquences de défilés de Fashions for Women, la chorégraphe apporte sa touche aux quatre premiers films d'Arzner. La presse vante à nouveau la mise en scène et la direction d'acteur : « Miss Ralston, jusqu'alors toujours filmée par des hommes, était uniquement vue comme une mannequin, ou une jolie silhouette sur laquelle suspendre des habits dans le seul but de la faire parader devant la caméra. Mademoiselle Arzner a réussi là où ses rivaux masculins ont échoué : sublimer à l'écran le charme et l'humour d'Esther Ralston, qu'aucun d'eux n'avait su voir », lit-on dans l'article de Fleet Smith, « Paramount's First Woman Director Puts Men to Shame ».
Et pourtant, ce film perdu est la dernière collaboration de Dorothy Arzner avec l'actrice qui la trouve trop exigeante et trop entreprenante. Retirée des écrans en 1940, la star aujourd'hui oubliée raconte dans son autobiographie tardive avoir expressément demandé à ne plus tourner sous la direction d'Arzner.
Clara Bow

Sacrée « it girl » avec le film It (Clarence Badger, 1927), Clara Bow est un des premiers sex-symbols d'Hollywood, croqueuse d'homme notoire et incarnation de la modernité. « Une gamine rousse, pleine de vie, avec un cœur d'enfant », selon Arzner. Et une personnalité proche de ses personnages de femmes émancipées, choquant la morale mais toujours honnête et courageuse. Façonnée par Ben Schulberg, chef de production le plus débauché de l'ère pré-Code, l'actrice fait aussi régulièrement la une des tabloïds. Mais la rousse flapper reste réticente à l'idée d'être dirigée par une femme. « Cela n'avait rien d'étonnant. Clara adorait flirter avec les hommes. Plus il y en avait sur le plateau, plus elle était heureuse », se souvient Dorothy Arzner, qui la met en scène en jeune Américaine à Paris face à la blonde Josephine Dunn dans Get Your Man (Il faut que tu m'épouses, 1927).
Le film (sixième et dernier de l'année pour Clara Bow) est bien reçu et ça « matche » entre l'actrice et la cinéaste. Les photos de studio les montrent complices, Bow tout sourire sur les genoux d'Arzner. La réalisatrice se voit confier le premier talkie de la star et un des premiers de la Paramount, prouvant la foi du studio en ses talents pour accompagner la vedette maison dans son passage au parlant. Accroche-cœur et mouche en cœur, Clara Bow pétille dans The Wild Party (Les Endiablées, 1929) avec Fredric March dans un de ses premiers rôles, et les filles de Marion Morgan, toujours aussi glamour.
Arzner invente au passage la perche pour faciliter les mouvements de l'actrice, tétanisée par le micro. Kenneth Anger rapporte dans son Hollywood Babylone : « L'éclat brooklynien de sa voix nécessitait de baisser les volumes pour l'entrée de la comédienne », laquelle faisait « sauter tous les modulateurs ». Le succès du film confirme encore la réputation de star maker de Dorothy Arzner. On parle même de l'éclosion d'une nouvelle Clara Bow dans Sound Waves : « Dorothy Arzner a encore découvert une nouvelle star à Hollywood ! Elle vient de faire éclore une nouvelle Clara Bow, encore plus éblouissante devant un micro qu'elle n'était dans ses films muets ! ». En 1930, leurs noms se croisent aux génériques de deux revues musicales cosignées par les réalisateurs phare de la maison (Paramount on Parade et Galas de la Paramount) mais elle ne tournent plus ensemble. Après une série de dépressions et de scandales sur ses frasques amoureuses, Clara Bow arrêtera le cinéma en 1933.
Ruth Chatterton

Enfant de la balle, sur les planches à Broadway depuis 1914, Ruth Chatterton fait partie de ces comédiennes de théâtre attirées par Hollywood avec l’arrivée du parlant. Elle a 35 ans passés lorsqu’elle débarque dans la ville du cinéma. Son premier « all talking picture », Madame X (Lionel Barrymore, 1929), fait d’elle la vedette la mieux payée du moment et lui vaut sa première nomination à l’Oscar de la meilleure actrice.
La seconde, elle la doit à son premier film avec Dorothy Arzner, Sarah and Son (1930) où elle compose un personnage de comédienne à l’accent allemand prononcé, face à Fredric March, jeune acteur montant que la cinéaste a précédemment fait tourner. Déjà réputée pour son habileté à filmer les actrices, Arzner se voit confier le projet pour asseoir la carrière de Ruth Chatterton. Écrit pour mettre en valeur l’actrice, ce mélo déchirant sur l’amour maternel marque le début de la collaboration d’Arzner avec Zœ Akins, auteur de ses trois films suivants [Anybody’s Woman, Working Girls et Christopher Strong]. Elle-même ancienne scénariste, Arzner la garde autant que possible sur le plateau, tant il est capital pour elle d’avoir recours aux scénaristes pendant le tournage. « Woman’s picture » dans tous les sens du terme, comme la critique ne manque pas de le remarquer, Sarah and Son fait fureur. « Ruth Chatterton était une bonne actrice, mais j’aime à penser que j’ai eu de l’influence sur sa trajectoire : la première fois que je l’ai faite tourner pour la Paramount, Sarah and Son a tout cassé au box-office. Pour la presse, Chatterton est devenue la première dame du grand écran » se souvient Arzner.
On prend donc les mêmes et on recommence avec Anybody’s Woman (1930), le populaire Clive Brooks incarnant avec l’actrice un drôle de couple – un divorcé et une artiste de music-hall mariés une nuit d’ivresse. La différence de classes est encore présente, négligés et jarretières aussi, quelques temps avant la mise en application du Code Hays. Deux ans plus tard, Ruth Chatterton part chez Warner qui cherche à changer son image avec des actrices sophistiquées et lui offre un contrat plus juteux. Elle quittera les écrans à la fin des années 30 pour se consacrer au théâtre et à l’aviation.
Claudette Colbert

Après des débuts à Broadway en 1924, Claudette Colbert est remarquée par Frank Capra, qui lui fait tourner son premier rôle dans For the Love of Mike en 1927 – un échec cuisant au box office. Elle ne retourne à l’écran qu’avec l’arrivée du parlant et un contrat de sept ans chez Paramount.
Honor Among Lovers (1931) est la troisième réalisation d’Arzner avec Fredric March, et Claudette Colbert a déjà partagé avec lui l’affiche de Manslaughter (George Abbott 1930). Pitch classique, au goût d’Arzner et parfaitement maîtrisé : un homme d’affaire est amoureux de sa secrétaire, épouse d’un looser alcoolique. Variety vante une mise en scène habile et délicate, des dialogues excellents et un casting brillant. À nouveau sa direction d’acteur est saluée à l’unanimité, malgré le succès mitigé du film. « J’ai participé à l’écriture de Honor Among Lovers que j’ai réalisé pour la Paramount à New-York. Il n’y a eu aucune pression, de toutes façons personne n’interférait sur mes films. Parfois, il y avait des discussions, à propos du casting, des décors, des costumes, mais en général j’avais toujours le dernier mot. Vous savez, je n’avais pas besoin de filmer pour gagner ma vie, donc je pouvais toujours refiler le scénario à un autre réalisateur si on m’empêchait de le filmer à ma manière. C’est comme ça que j’ai pu tenir 20 ans à Hollywood », précisera Arzner.
Cette comédie sentimentale ouvre sans doute la voie au premier grand succès de l’actrice, The Sign of the Cross (Cecil B. DeMille, 1932), toujours avec Fredric March – qu’Arzner était allé chercher pour Wild Party en 1929. Le tandem est reformé dans Make Me a Star (William Beaudine, 1932) et Tonight Is Ours (Stuart Walker, 1933). Et Claudette Colbert joue à nouveau les secrétaires dans Secrets of a Secretary (George Abbott, 1931) et She Married Her Boss (Gregory La Cava, 1935). La petite française est sur le point de devenir une des incontournables ladies du cinéma américain jusque dans les années 50.
Ginger Rogers

Un concours de Charleston et une expérience théâtrale en poche, Ginger Rogers fait partie des nouvelles recrues de la Columbia en 1929. Elle a 18 ans et foule encore les planches lorsqu’elle tape dans l’œil de Dorothy Arzner qui la recrute en 1930 pour un rôle secondaire dans Honor Among Lovers : « Ginger Rogers était une star du théâtre. Je l’ai vue sur scène, l’ai beaucoup aimée et lui ai proposé un petit rôle dans Honor Among Lovers. Elle a continué Girl Crazy au théâtre. Je n’ai jamais croisé sa mère ». La légendaire mère de l’actrice, qui conduit la carrière de sa fille d’une main de fer, est réputée pour ne jamais la quitter d’une semelle. Lela Rogers ne met pourtant pas les pieds sur le plateau de Honor Among Lovers. Parce qu’il est réalisé par une femme ?
Dans son sixième long-métrage, la future star incarne une ravissante idiote, fiancée d’un employé de Fredric March (Charlie Ruggles). Le personnage de Doris Brown se résume à quelques scènes courtes et 4 ou 5 lignes de dialogues mais la présence de Ginger Rogers est remarquée. « Claudette Colbert et Fredric March ont hérités de personnages formidables, et sont à leur meilleur. Le reste du casting, Charles Ruggles et Ginger Rogers, sont tout aussi excellents » relève le Motion Picture Herald. « Il n’y a pas de petits rôles, seulement de petits acteurs » disait d’ailleurs Ginger Rogers, reprenant à son compte une citation de Constantin Stanislavski. Pas encore blonde, la rousse Ginger s’apprête à s’envoler vers les hautes sphères de la comédie musicale : 3 ans plus tard, elle tourne Carioca (Thornton Freeland, 1933), son premier film avec Fred Astaire, dont elle allait devenir la partenaire attitrée durant les années 30 et 40.
Sylvia Sidney

Entrée à 15 ans à la Theatre Guild School, sur les planches à 16, Sylvia Sidney fait sa première apparition à l’écran en 1927, comme chorus girl mais préfère repartir à Broadway. C’est le producteur Ben P. Schulberg qui la convainc de rejoindre les prestigieux studios Paramount en 1931, aidé par Cupidon et la promesse du rôle principal dans An American Tragedy (Josef von Sternberg). La timide Sylvia remplace la mutine Clara Bow dans le cœur du patron de la Paramount et à l’écran dans City Streets (Rouben Mamoulian, 1931). Petite, fragile et délicate, le visage rond, son physique atypique la singularise des autres stars féminines de la firme : Marlene Dietrich, Carole Lombard, Kay Francis, Mae West et Claudette Colbert.
Son nom passe encore après celui de l’acteur principal sur les affiches quand il n’est pas écrasé par celui du producteur Sam Goldwyn qui l’emprunte la même année pour Street Scene (King Vidor). Il faudra attendre le Merrily We Go to Hell (1932) de Dorothy Arzner, qui lui offre un de ses premiers grands rôles, pour la voir citée en haut de l’affiche, devant son partenaire et devant le titre. Un titre comme seule l’ère pré-Code a pu en produire, deux ans avant le renforcement de la censure et un an avant la fin de la prohibition. Et un toast récurrent porté par Fredric March, qui vient d’expérimenter la double personnalité dans Dr. Jekyll and Mr. Hyde (Rouben Mamoulian, 1931) et que la réalisatrice était allée chercher avant tout le monde. Sylvia Sidney y incarne une fille-à-papa-industriel-de-la-boisson, qui succombe aux charmes du journaliste trop porté sur la bouteille et l’épouse, un tire-bouchon en guise d’alliance oubliée. La haute société s’abandonne à l’alcool, évoquant les soirées hollywoodiennes qui font alors les choux gras des tabloïds, tandis que la jeune héritière essaie de se résoudre à l’idée d’un mariage moderne, autorisant son époux à fréquenter son ex, quand elle-même se pavane au bras du jeune premier Cary Grant.
Il y a déjà tout Sylvia Sidney dans Merrily We Go to Hell : victime vulnérable et courageuse de l’éthylisme de son mari, avec une sensibilité à fleur de peau dont la caméra de Dorothy Arzner capte toute la photogénie et fixe une image étincelante, œil humide et tenues scintillantes à l’appui. La composition de l’actrice est dans la lignée de ses rôles à venir, principalement dans des mélodrames sociaux de la Grande dépression, dont elle n’arrivera jamais vraiment à se départir : filles à gangsters ou filles-mères en détresse, avec les yeux les plus tristes de Hollywood, qu’illustre parfaitement le titre de son autobiographie Paid by the tear. Sylvia Sidney est en passe de devenir une des grandes stars des années 30, toujours mal accompagnée dans le Sabotage d’Hitchcock (1936) ou dans les trois premiers films américains de Fritz Lang, Fury (1936), You only Live Once (1937) et You and Me (1938). « Merrily we go to Hell a été son premier grand rôle, et un énorme succès. Dans la plupart de ses films suivants, elle a aussi souffert, et survécu à ses souffrances. » considère la cinéaste à propos de son actrice.
Katharine Hepburn

Après des débuts d’actrice à Broadway, plus ou moins couronnés de succès, Katharine Hepburn débarque à Hollywood dans un film de George Cukor, A Bill of Divorcement (Héritage, 1932) où elle joue la fille de John Barrymore et Billie Burke. Elle a 25 ans et échappe de peu à une série B exotique grâce à Dorothy Arzner, croisée sur un plateau.
La cinéaste lui offre un deuxième rôle en or, le personnage central de son Christopher Strong (La Phalène d’argent, 1933), d’après un roman anglais réécrit avec Zœ Akins, déjà trois fois sa scénariste : « David Selznick m’a demandé de réaliser un film pour la RKO, qu’il dirigeait à l’époque. Le film était écrit pour Ann Harding, mais des problèmes contractuels l’ont éloignée du projet. J’ai choisi Katherine Hepburn après l’avoir rencontrée dans les studios. Elle était bien dans Bill of Divorcement, mais tout ce qui lui avait été proposé ensuite était un sous-Tarzan. Je suis arrivée sur le plateau, elle était en haut d’un arbre, vêtue d'une peau de léopard. Sa silhouette était magnifique, et en lui parlant, j’ai réalisé qu’elle incarnait parfaitement cette femme moderne que je voulais pour Christopher Strong ». Un rôle à sa mesure, celui de Lady Cynthia Darrington, aviatrice tiraillée entre sa passion pour le vol et son amour adultère pour un politicien plus âgé, dans lequel elle est plus que convaincante. Photographiée par Bert Glennon, Hepburn a une présence étonnante et unique aux côtés de Billie Burke et Helen Chandler dans ce mélodrame assez subversif, comme l’autorise encore Hollywood avant la mise en place du Code. Indépendante, fière, spirituelle et désinvolte, l’actrice a déjà le style et l’élégance inimitable qui la caractérise. Elle apparaît éclatante dans une multitude de tenues qui rivalisent toute d’originalité, de l’incroyable costume de phalène d’argent, en lamé moulant sa silhouette athlétique et androgyne, à l’équipement d’aviateur en passant par ses robes de soirée.
Libres et déterminées, Dorothy Arzner et Katharine Hepburn partagent aussi une garde-robe constituée de pantalons, loin des stéréotypes féminins et des conventions. La première assume son homosexualité, la seconde se verra prêter des liaisons féminines. Malgré leurs points communs, l’expérience du tournage n’aurait pas été plaisante entre la réalisatrice et la comédienne qui retournera vite à Cukor, tournant encore 7 films avec lui. Pour Arzner, qui a quitté la Paramount afin de devenir free lance, le film est un challenge. Elle aurait dirigée Hepburn d’une main de fer, ne prenant pas le temps de la connaître plus intimement et la jugeant trop hautaine. La cinéaste se serait plainte à Selznick que l’actrice tentait d’interférer dans sa réalisation. À l’inverse de ses biographes, Hepburn affirmera : « Dorothy Arzner avait déjà réalisé pas mal de film. Était très douée… Elle portait des pantalons. Moi aussi. Nous avons adoré travailler ensemble. ». Quoi qu’il en soit, la route est tracée grâce à Christopher Strong. Le film suivant d’Hepburn, Morning Glory (Gloire éphémère, Lowell Sherman, 1933) allait lui valoir le premier des quatre Oscar qu’elle remportera (score record). En 1975, l’actrice devenue la légende qu’on sait se manifestera lors d’un hommage de la Director’s Guild of America à la réalisatrice, par le biais d’un télégramme: « N’est-ce pas formidable d’avoir eu une si belle carrière, à une époque où vous n’aviez même pas le droit d’avoir en une ? »
Anna Sten


Découverte à l’âge de 15 ans par Constantin Stanislavski, Anna Sten a débuté sur les planches en Russie et fait ses premiers pas au cinéma en 1926. La jeune épouse de Fedor Ozep a 13 films russes et allemands au compteur quand Samuel Goldwyn flashe sur elle en 1932. Lui aussi veut sa star exotique, à l’instar de Greta Garbo à la MGM et Marlene Dietrich à la Paramount. Le producteur ramène à Hollywood la jeune beauté ukraino-suédoise avec un contrat faramineux ($3,000 a week plus expenses). Et les publicitaires de la Samuel Goldwyn Company d’annoncer l’arrivée d’une Anna Sten, tout juste importée, « plus sexy que Dietrich, plus mystérieuse que Garbo et meilleure actrice que Norma Shearer ». Le producteur décide de lancer sa star avec Nana d’Émile Zola. Il mise tout sur elle, briguant l’Oscar, mais ce n’est pas gagné : l’actrice ne parle pas un mot d’anglais et ne sait ni danser, ni chanter. Et malgré une année de cours intensifs, le tournage du premier film américain de l’actrice n’est pas évident : « Je me fiche du prix que cela me coûtera. C’est mon argent, et nous tournerons jusqu’à ce je sois satisfait » clame Goldwyn.
Après avoir viré le pourtant expérimenté George Fitzmaurice (à un stade de réalisation bien avancé) et essuyé un refus de Cukor (déjà réputé Woman’s Director), c’est vers Dorothy Arzner que se tourne Goldwyn pour prendre les rênes de son Nana en 1934 : « Goldwyn m’a choisie pour Nana après avoir vu, et adoré, Christopher Strong lors d’un voyage en Europe. Il a casté Anna Sten, qu’il espérait voir tutotyer les sommets aux côtés de Dietrich ou Garbo. J’aurais aimé faire le film à ma façon, avec un script solide. Mais Goldwyn ne l’entendait pas ainsi, et j’ai dû composer avec sa cinquantième version du scénario ». Dorothy Arzner restructure entièrement le film – qui s’avère une entreprise risquée avec le nouveau Code entré en vigueur en 1934 – et doit faire avec la version aseptisée des scénaristes de Goldwyn, très éloignée de l’œuvre originale. Sans compter la performance de l’actrice qui relève d’une mauvaise imitation de Marlene.
Louella Parsons, chroniqueuse mondaine et plus grande commère d’Hollywood, convient pourtant à l’époque : « quant à Dorothy Arzner, elle est l’une des meilleures pour filmer les actrices. Elle comprend la psychologie féminine, et c’est primordial ». Mais malgré tous les talents de star-maker d’Arzner, la superbe photo de Gregg Toland, les costumes d’Adrian et de Travis Banton, sans compter les gros moyens déployés pour la promotion du film (25 % des billboards new-yorkais), Anna-Nana ne fait pas vibrer le public américain. Ni Léon Tolstoï, ni les réalisateurs suivants (Rouben Mamoulian, King Vidor) ne feront plus décoller la « Goldwyn folly », vite reléguée aux seconds rôles ou séries B, puis oubliée.
Joan Crawford
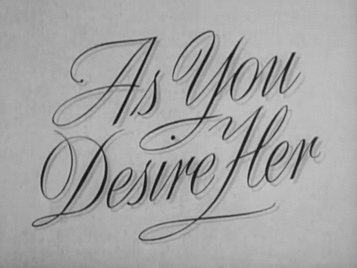

Joan Crawford prend sa carrière en main depuis 1925 à la MGM et a déjà atteint le rang de star lorsqu’elle croise le chemin de Dorothy Arzner en 1937. La cinéaste termine le tournage de The Last of Mrs. Cheyney, comédie commencée par Richard Boleslawski, subitement décédé avant la fin, et complétée par George Fitzmaurice, tombé malade. Joan Crawford incarne une voleuse jouant à la veuve fortunée dans ce remake d’un film homonyme de 1929, avec sa rivale Norma Shearer. Elle est peu habituée au genre et le film n’explose pas le box office. « J’avais des problèmes personnels à l’époque, qui ont empiété sur mon travail. Si j’avais bien fait les choses, je suis sûr que j’aurais décroché une nomination à l’Oscar » estimera l’actrice. Et bluffée par le dernier film d’Arzner, Craig’s Wife (1936) – rôle titre qu’elle finira par interpréter dans le remake Harriet Craig en 1950 – Crawford aurait demandé à travailler à nouveau avec la réalisatrice.
Enthousiaste, Dorothy Arzner rejoint les plateaux de MGM pour The Bride Wore Red (L’Inconnue du palace, 1937), d’après une pièce inédite de Ferenc Molnar, grossièrement édulcorée par les scénaristes du studio pour faire de l’héroïne prostituée une Cendrillon. Le personnage est dans la lignée des ambitieuses aux origines modestes souvent incarnés par Crawford, et typiques des mélodrames de la Grande dépression. Au centre d’un triangle romantique avec Franchot Tone et Robert Young, elle incarne une chanteuse des bas-fonds, victime heureuse d’un pari, qui se fait passer pour une fille de la haute-société le temps d’un séjour dans un palace tyrolien. Le trio a déjà été réuni dans Today We Live (Howard Hawks, 1933) et l’actrice retrouve pour la septième fois Franchot Tone, son deuxième mari. Elle est resplendissante dans les somptueux costumes d’Adrian, costumier star de la MGM qui a façonné son look et l’habille à l’écran comme à la ville de 1929 à 1943, accentuant les épaules masculines de sa silhouette de femme de tête. « Joan Crawford est resplendissante dans The Bride Wore Red, avec sa nouvelle coiffure et des yeux plus grands que jamais. La fameuse magie Crawford fonctionne parfaitement : elle est à la fois une souillon, une grande dame et une paysanne » note à l’époque le New-York Herald Tribune.
L’histoire commençait bien mais les critiques du film ne sont pas bonnes et la légende hollywoodienne à la carrière record est alors au creux de la vague. Elle est surnommée « The Box Office Poison » en 1938, dans un article la pointant avec d’autres consœurs aux salaires démentiels. Pour Arzner, The Bride Wore Red marque le début de la fin. Plus tyrannique que Harry Cohn à la Columbia, Louis B. Mayer interfère dans les décisions de la réalisatrice qui ose lui résister. Sexiste et homophobe, il la suspendra après deux ou trois scripts refusés et lui vouera une hostilité éternelle. Arzner le tiendra en partie responsable de la fin de sa carrière : « Mayer a laissé entendre que j’étais ingérable, et vous savez comment les producteurs parlent entre eux… je pense que c’est la raison pour laquelle j’ai fini par partir ». Le tournage n’a finalement pas été une partie de plaisir : Arzner et Crawford auraient fini par ne plus communiquer que par messages. La rumeur d’une liaison amoureuse entre la cinéaste et la star, qui avoue quelques aventures lesbiennes, n’a jamais été confirmée mais Crawford rapporte : « J’aime à penser que tous les réalisateurs avec qui j’ai travaillé sont tombés amoureux de moi. Je sais que ce fut le cas de Dorothy Arzner ». Les deux femmes resteront amies et Arzner réalisera dans les années 60, quelques pubs pour Pepsi Cola à la demande de l’actrice, épouse en quatrième noce du patron de la firme. En 1978, Arzner dira d’elle : « Sa mort est une perte immense. J’ai perdu une amie très chère, et nous avons tous perdu la femme qui a incarné le mot star ».
Rosalind Russell

Avant de personnifier LA working girl à l’écran, Rosalind Russell fait ses débuts à la MGM en 1934, au mieux comme faire-valoir des stars maison : Jean Harlow, Joan Crawford, Maureen O’Sullivan, Claudette Colbert et Myrna Loy. « À la MGM, il y avait les superstars, et une deuxième vague juste d’actrices en retrait, pour remplacer les plus ingérables. J’étais en seconde ligne, derrière Myrna. » se rappelle l’actrice. Deux ans plus tard, elle va pourtant taper dans l’œil de Dorothy Arzner, à la recherche de son héroïne pour Craig’s Wife (1936), produit par la Columbia d’après la pièce de George Kelly – l’oncle de Grace – qui lui avait valu un prix Pulitzer en 1926. Une version muette a déjà été réalisée en 1928 par William C. de Mille, le frère aîné de Cecil B. DeMille qui avait introduit Arzner chez Famous Players-Lasky en 1919. Pour son remake, le producteur Harry Cohn estime que les actrices du studio, Irene Dunne, Jean Arthur, Ann Sothern et Faye Wray, ne font pas l’affaire. Le personnage est antipathique et le rôle peu engageant pour une jeune première. Une fois n’est pas coutume, Arzner partage l’avis du patron et jette son dévolu sur Rosalind Russell : « Je ne voulais pas d’une actrice que le public adore. Rosalind Russell était reléguée au rôle de second couteau à la MGM, quasi inconnue du grand public. Elle était ce que je recherchais ».
Empruntée à la MGM après avoir tenté de se défiler, Russell est contrainte d’accepter le rôle d’Harriet Craig, monstre sans cœur pour qui le mariage n’est qu’un contrat d’affaire, obsédée par sa maison plus que par l’histoire de meurtre à laquelle son mari se trouve mêlé et qui menace son quotidien aseptisé. Arzner remplace vite le chef décorateur initial par son ami William Haines, décorateur d’intérieur des stars hollywoodiennes, avec lequel elle imagine la demeure, lieu de l’exercice du pouvoir devenu personnage à part entière. En étroite collaboration avec la scénariste Mary McCall, la cinéaste livre une version éloignée de l’œuvre originale, avec une Mrs Craig si complexe que l’auteur ne la reconnaît plus. La cinéaste réussit un tour de force : « J’ai dit à Harry Cohn que j’allais lui livrer un film de prestige avec un budget de série B. Il s’est laissé prendre au jeu. Le film n’a pas été un triomphe à sa sortie, mais il a eu une excellente presse, est resté longtemps à l’affiche et a fini sur le long par rapporter beaucoup d’argent ». Mais surtout, le film révèle Rosalind Russell sous un jour nouveau et l’oriente vers un type d’emploi qui va lui coller à la peau.
Aussi grande qu’arrogante, Russell incarnera ensuite les carriéristes plus ou moins pestes, une bonne vingtaine de fois à l’écran. « Hormis les rôles masculins et un changement de fonction et de coiffure, tous mes personnages étaient calqués sur celui d’Alice au pays des merveilleuses carrières. Dans tous ces films, ma garde-robe était immuable : un tailleur marron, un tailleur gris et un tailleur beige, et quand-même un négligé pour la septième bobine, vers la fin, quand je voulais bien avouer à mon meilleur ami au téléphone, que ma seule aspiration était de devenir une gentille petite femme d’intérieur ». Ingrate Rosalind Russell ? Dans son autobiographie, aucune mention d’Arzner et très peu d’attention à Craig’s Wife malgré son succès, un second remake et deux adaptations radio où l’actrice reprend son rôle. Occultant sa performance cruciale de ménagère mégère chez Arzner, Russell préfère citer son rôle de commère malveillante tourné trois ans plus tard dans The Women (George Cukor, 1939), comme celui qui l’a fait décoller. Et pourtant, Arzner le confirme : « I saw the star quality in her before anyone else did ».
Billie Burke

Fille d’un clown célèbre qui sillonnait les États-Unis et l’Europe, la timide Billie Burke a très jeune conquis Londres et Broadway, au début du siècle dernier. Son mari Florenz Ziegfeld – producteur des célèbres Follies, qu’elle dirigera un temps – l’incite à faire ses débuts au cinéma dès 1916 (Peggy, Thomas Ince). La comédienne reste à l’affiche jusqu’en 1921 mais préfère la scène au cinéma encore muet.
Billie Burke attend le parlant et la mort de Ziegfeld pour revenir à Hollywood. À l’approche de la cinquantaine, elle inaugure une nouvelle carrière de mère avec A Bill of Divorcement (George Cukor, 1932), poursuivie l’année suivante dans Christopher Strong (Le Phalène d’argent, 1933) où elle retrouve Katharine Hepburn devant la caméra de Dorothy Arzner. Épouse délaissée de Colin Clive et mère d’Helen Chandler, elle campe une Lady Strong plus complexe et émouvante que la simple femme trahie. Délicate et bavarde, souvent vêtue de blanc, la blonde Billie Burke incarne la douceur féminine face à l’androgyne Lady Cynthia Darrington. La cinéaste avouera avoir « accordé une attention particulière au jeu de Billie Burke », une de ses actrices préférées avec laquelle a entretenu une liaison. Dorothy Arzner la dirige à nouveau dans le deuxième rôle féminin de Craig’s Wife (L’Obsession de Madame Craig, 1936), celui de Mrs. Frazier, la voisine d’Harriet Craig qui lui donnera l’occasion de se racheter. Billie Burke donne du relief à ce personnage de veuve d’à côté s’occupant des roses de son jardin, moins stéréotypée et pathétique que dans la pièce à laquelle Arzner et sa scénariste Mary McCall ont apporté des changements importants. La réalisatrice joue encore sur le contraste avec la brune, sévère et sombre Mrs. Craig, personnifiée par Rosalind Russell. Dorothy Arzner fait encore appel à Billie Burke pour le même type de rôle, face à Joan Crawford dans The Bride wore Red (L’inconnue du palace, 1937), où elle interprète la Contessa di Meina, belle-mère de Maddelana (Lynne Carver) dont Crawford va séduire le fiancé. Entretemps, l’actrice tourne le premier opus de la populaire série des Topper, avant d’être nominée aux Oscars pour son second rôle dans Merrily We Live (Norman Z. McLeod, 1938) et d’incarner la bonne fée du Magicien d’Oz (1939). Après avoir quitté Hollywood, Dorothy Arzner produira plusieurs pièces de théâtre avec Billie Burke (HATS OFF! Miss Smith, The Swallow’s Nest et Mother Was a Bachelor), montées en Californie dans les années 50. La comédienne jouera encore les mères chez Vincente Minnelli (Father of the Bride et sa suite Father’s Little Dividend) et fera sa dernière apparition dans Sergeant Rutledge (Le Sergent noir, John Ford, 1960), non sans être passée par la télévision, le temps d’œuvrer pour six décennies de spectateurs américains.
Lucille Ball


Lucille Ball débute en 1933 comme chorus girl pour Samuel Goldwyn avant de compter parmi les danseuses du Nana (1934) de Dorothy Arzner. C’est le sixième film de l’actrice qui en tourne une trentaine sans être créditée avant de décrocher un rôle plus important dans Stage Door (Gregory La Cava, 1937) et de tourner à nouveau sous la direction de Dorothy Arzner dans Dance, Girl, Dance (1940).
La réalisatrice reprend les rênes du projet cher au producteur Erich Pommer, à la suite de Roy Del Ruth qui a abandonné le film après deux semaines de tournage. Pas encore rousse mais moins timide qu’à ses débuts, Lucille Ball interprète le second rôle féminin face à la tête d’affiche irlandaise qui a débutée l’année précédente sous le nom de Maureen O’Hara chez Hitchcock (Jamaica Inn, 1939). Toutes deux danseuses dans une troupe, la vertueuse ballerine Judy incarnée par la rousse Maureen O’Hara travaille d’arrache-pied face à la blonde Bubbles interprétée par Lucille Ball, piège à hommes impulsive qui préfère le strip-tease burlesque. Elles personnifient à elles-deux la rivalité de l’art contre le commercial. Et la composition de la jeune Lucille Ball en bad-girl qui veut passer avant tout le monde est remarquée. Arzner capte déjà tout le potentiel comique de l’actrice qui rencontre Desi Arnaz pendant le tournage du film, œil au beurre noir et pansement sur l’arcade sourcilière. Mariés avant la fin de l’année, le couple enchaînera avec Too Many Girls (George Abbott, 1940), où l’actrice tient enfin le rôle principal, et s’apprête à former le tandem le plus populaire des années 50 dans la prolifique série TV, I Love Lucy.
Maureen O’Hara tient dans Dance, Girl, Dance le discours le plus explicitement féministe exprimé chez Dorothy Arzner, qui ne souhaitait pourtant être identifiée comme telle, pas plus que comme cinéaste lesbienne. Souvent cité, cet avant-dernier film d’Arzner demeure le plus connu de la réalisatrice qui ne terminera pas le suivant, First Comes Courage (1943), achevé par Charles Vidor pour des raisons demeurées obscures.